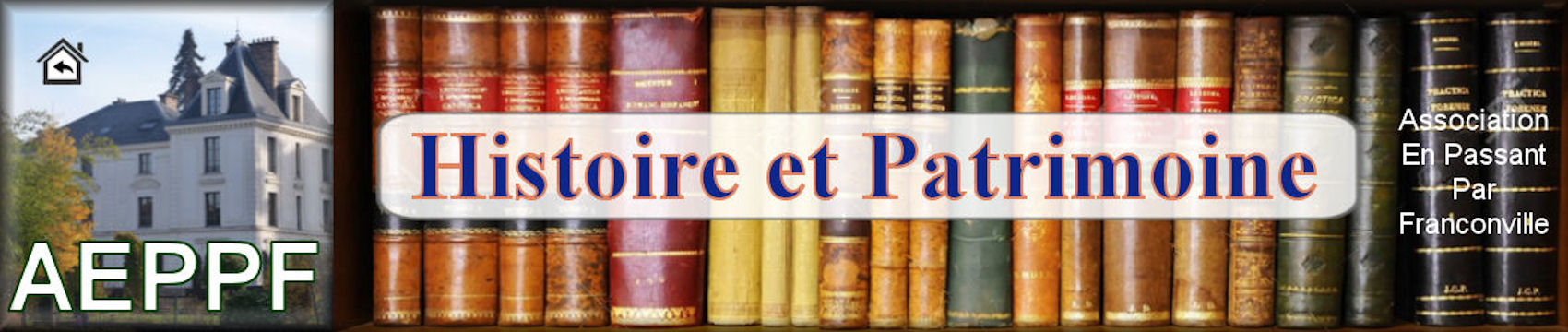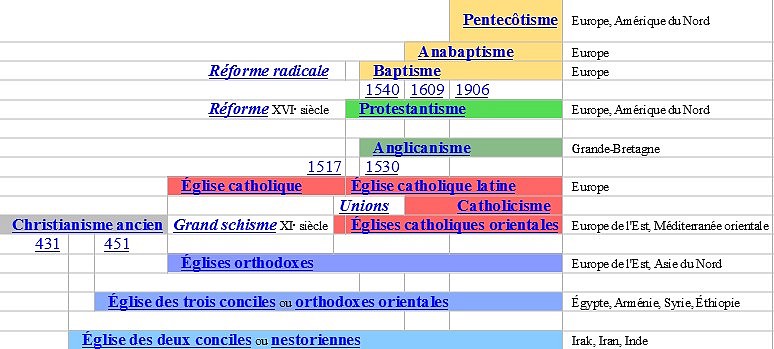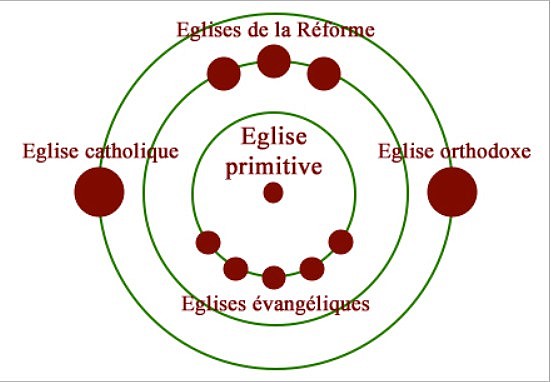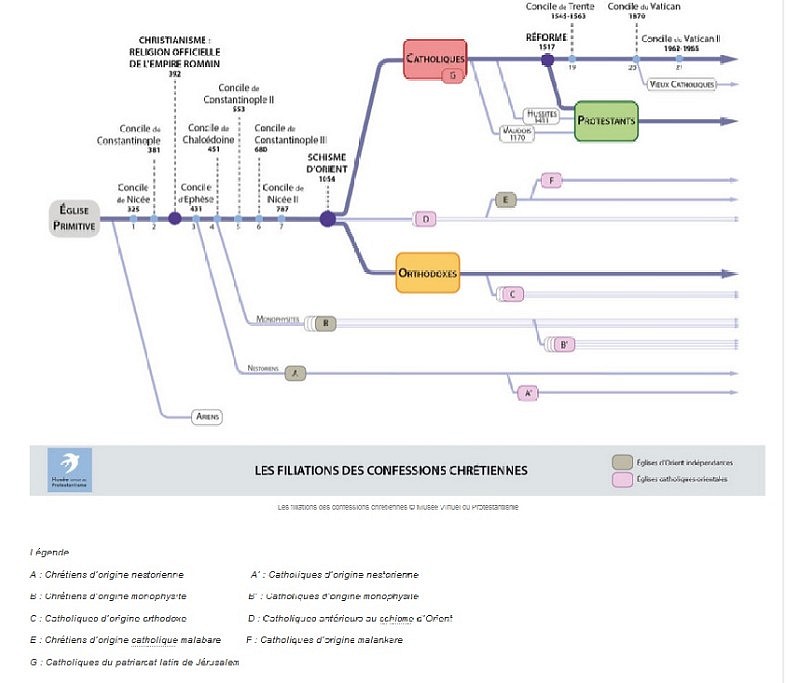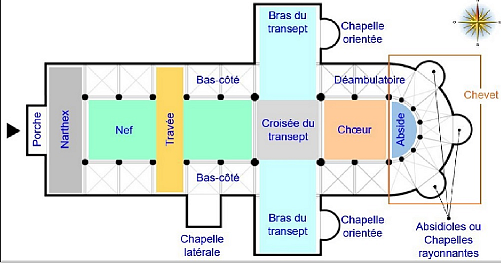Les lois de l’église catholique Par Fernand Ménigoz
Les lois
Can. 7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.
Can. 8 - § 1. Les lois universelles de l’Église sont promulguées par leur publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit ; elles n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.
§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai.
Can. 9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne disposent nommément pour le passé.
Can. 10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou in habilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou une personne inhabile.
Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.
Can. 12 - § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.
§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.
§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du can. 13.
Can. 13 - § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus :
1 Par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles.
2 Ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sises sur ce territoire.
§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.
Can. 14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou in habilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, l'autorité à qui est-elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.
Can. 15 - § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou in habilitantes n'empêche pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse.
§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d'autrui qui n'est pas notoire.
Can. 16 - § 1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.
§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.
§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi ; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l'interprétation est donnée.
Can. 17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.
Can. 18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d'interprétation stricte.
Can. 19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.
Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière ; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.
Can. 21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.
Can. 22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.
Le droit canonique
Des lois sont nécessaires dès que des gens vivent ou travaillent ensemble. L’Église a son propre système de droit, appelé « droit canonique ».
Le droit canonique ou droit canon (Jus canonicum en latin) est l'ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l'Église et de ses fidèles. Le droit canonique n'a pas de portée sur les accords conclus par l'Église, ni sur les questions de dogme à proprement parler, quoiqu'il faille relativiser (le pape Jean-Paul II a en effet inséré, dans le code de 1983, l'interdiction faite aux femmes d'accéder à l'ordination en engageant la foi de l'Église). En ce qui concerne la liturgie, le code ne donne que des orientations dans la partie liée à la charge ecclésiale de sanctifier ; les normes liturgiques se trouvent dans la présentation des divers rituels.
Ces normes ont force de loi et doivent être respectées car, pour certaines d'entre elles, il y va de la validité du sacrement. Tous les rituels ne concernent pas les sacrements, et il convient, là aussi, de respecter les normes, en particulier pour les funérailles. En ce qui concerne la messe, les normes se trouvent dans la PGMR (Présentation Générale du Missel Romain). La dernière PGMR a été publiée par Jean-Paul II en 2002, et traduite en français par le CNPL. Le nouveau missel, publié également en 2002, n'a pas encore été traduit en français.
La règle, le modèle. Le terme a rapidement pris une connotation ecclésiastique en désignant au IVe siècle les ordonnances des conciles, par opposition au mot νόμος / nómos (la coutume, la loi) utilisé surtout pour les lois des autorités civiles.
Du fait de cet usage, le terme canoniste renvoie ordinairement à un expert de ce droit interne de l'Église, tandis qu'un juriste peut être expert de droit religieux ou ecclésiastique s'il connaît le droit de son pays touchant aux diverses religions.
Le Code de droit canonique de 1983
À l'heure actuelle, le Code faisant autorité dans l'Église latine est celui de 1983. Il a été promulgué par Jean-Paul II le 25 janvier 1983 et tient compte des profonds changements apportés par le concile Vatican II. Les Églises catholiques orientales sont soumises, elles, au Code des canons des Églises orientales (1990).
Son idée a germé dès 1959 dans l'esprit de Jean XXIII. Elle a été ensuite reprise par Paul VI, qui établit les schémas directeurs du nouveau code. Mais ce n'est qu'en 1981 qu'une commission se met véritablement au travail.
Le code de 1983 met moins l'accent sur le caractère hiérarchique et ordonné de l'Église. Il veut au contraire promouvoir l'image d'une Église-peuple de Dieu (référence explicite à la constitution de 1964 Lumen Gentium) et d'une hiérarchie au service des autres (can. 204) :
« Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.
Le code développe notamment les possibilités d'adaptations pour tenir compte des impératifs pastoraux et instaure un régime plus souple pour les dispenses (relâchement de la loi dans un cas particulier). Néanmoins, ce nouvel éventail de possibilités n'a pas toujours été bien perçu, le manque de formation des prêtres empêchant souvent son application ou engendrant des difficultés.
Le droit canon est divisé en titres et en chapitres (liste des normes générales livre 1)
TITRE I : les lois de l'église (cann. 7 - 22).
TITRE II : la coutume (cann. 23 -28).
TITRE III : les décrets généraux et les instructions (cann. 29 - 34) .
TITRE IV : les actes administratifs particuliers (cann. 35 - 93).
Chapitre I : normes communes.
Chapitre II : les décrets et les préceptes particuliers.
Chapitre III : les rescrits.
Chapitre IV : les privilèges.
Chapitre V : les dispenses.
TITRE V : les statuts et les règlements (cann. 94 - 95).
TITRE VI : les personnes physiques et juridiques (cann. 96 - 123).
Chapitre I : la condition canonique des personnes physiques.
Chapitre II : les personnes juridiques.
TITRE VII : les actes juridiques (cann. 124 – 128).
TITRE VIII : le pouvoir de gouvernement (cann. 129 - 144).
TITRE IX : les offices ecclésiastiques (cann. 145 - 196).
Chapitre I : la provision de l'office ecclésiastique.
Chapitre II : la perte de l'office ecclésiastique.
TITRE X : la prescription (cann. 197 - 199).
TITRE XI : le calcul du temps (cann. 200 - 203).
Il existe d’autres livres des lois canoniques
Livre II Le peuple de Dieux qui concerne les obligations des fidèles.
Livre III La fonction d'enseignement de l'église.
Livre IV La fonction de sanctification de l'église (cann. 834 - 848).
Livre V Les biens temporels de l'église.
Livre VI Les sanctions dans l'église.
Livre VII Les procès.
Les commandements
Le Décalogue— les Dix Paroles pour le judaïsme, traduit par les Dix Commandements pour le christianisme — est un court ensemble écrit d'instructions morales et religieuses reçues, selon les traditions bibliques, de Dieu par Moïse au mont Sinaï.
Les 10 commandements
Les 10 commandements sont une recommandation forte, insistante de Dieu permettant aux hommes de construire une relation en les laissant libres de leurs actes. C’est un appel à l’amour et à la liberté qui structurent la relation aux personnes.
Le Décalogue (dix paroles) se comprend d’abord dans le contexte de l’Exode qui est le grand événement libérateur de Dieu au centre de l’Ancienne Alliance. Qu’elles soient formulées comme préceptes négatifs, ou comme commandements positifs, ces « dix paroles » indiquent les conditions d’une vie libérée de l’esclavage. C’est un chemin de vie qui sépare d’une pratique ambiante non éthique. Dans la foi chrétienne, les dix paroles s’articulent autour de l’unique et même commandement de l’amour de Dieu et du prochain.
Souvent on oppose à la morale des dix commandements (la loi), celle des Béatitudes (la promesse).
Cette opposition est factice. Les deux textes désignent deux faces différentes de la même « morale ».
Livre de l’Exode 20, 1-18 : dans la Bible et la foi chrétienne, l’Exode désigne la libération des tribus israélites de l’esclavage d’Egypte et le don de la Loi au Sinaï.
Et Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.
Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu’à la millième génération.
Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal.
Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a consacré.
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. ».
Les commandements de l’église
Les commandements de l’Église se placent dans cette ligne d’une vie morale reliée à la vie liturgique et se nourrissant d’elle. Le caractère obligatoire de ces lois positives édictées par les autorités pastorales, a pour but de garantir aux fidèles le minimum indispensable dans l’esprit de prière et dans l’effort moral, dans la croissance de l’amour de Dieu et du prochain .
Les Dimanches et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Sainte Messe et de s’abstenir des œuvres serviles.
Tout fidèle est tenu par l’obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an.
Tout fidèle est tenu par l’obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques.
Aux jours de pénitence fixés par l’Église (mercredi des cendres, vendredi saint et tous les vendredis du temps de carême), les fidèles sont tenus par l’obligation de s’abstenir de viande et d’observer le jeûne.
Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église chacun selon ses possibilités.
L’Église et les différentes lois gouvernementales par Fernand Ménigoz
L'État et les cultes - Laïcité et loi de 1905
"La France est une République laïque" selon l’article 1er de la Constitution de 1958. En 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions "interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers".
Publié le 3 avril 2019 à 10h24
L’Ancien Régime, une monarchie de droit divin :
Un lien étroit entre Eglise et Etat
L’Ancien Régime (jusqu’en 1789, année de la Révolution Française) repose sur les points suivants :
Les lois et les dogmes de l’Église sont des lois de L’État que le « Roi très chrétien » doit faire respecter, la religion catholique étant la seule reconnue dans le Royaume.
L’Église est alors le plus gros propriétaire foncier de L’État. Ses revenus lui permettent de faire vivre le Clergé mais aussi d’entretenir les hôpitaux et les hospices, les écoles et les collèges puisqu’à cette époque L’État n’assure pas ces services.
La période révolutionnaire
1789
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen reconnaît la liberté de conscience : "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi".
Novembre 1789
Un décret met les biens du clergé à la disposition de la Nation. En contrepartie, l’État s’engage à "pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises, presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres".
Décembre 1789
Les protestants sont reconnus en tant que citoyens et sont admis à tous les emplois.
1790
Adoption de la Constitution civile du clergé. L’Assemblée constituante assigne aux diocèses les limites des départements et brise la hiérarchie de l’appareil ecclésiastique. Les desservants de l’Église reçoivent un salaire de l’État et doivent prêter serment à la Constitution civile du clergé. La moitié des ecclésiastiques environ refuse de prêter serment et, bientôt, deux Églises s’opposent, l’une traditionnelle et fidèle au pape et l’autre constitutionnelle.
1791
Septembre 1791
L’Assemblée constituante accorde le statut de citoyen aux juifs. Cette qualité avait déjà été reconnue aux juifs séfarades des régions de Bordeaux et d’Avignon en 1790.29 novembre 1791
L’Assemblée législative adopte un décret qui déclare suspects et privés de leur pension les ecclésiastiques réfractaires qui ont refusé de prêter serment. Les édifices religieux ne peuvent être utilisés que par le clergé salarié par l’État.
1792
Institution de l’état civil séculier. Les registres d’état civil, jusqu'alors tenus par l’Église, sont transférés aux communes. Celles-ci consignent désormais naissances, mariages et décès. Le mariage civil devient la forme légale du mariage.
1794
7 mai 1794
Un décret du 18 floréal an II, adopté par la Convention sur le rapport de Robespierre, institue un calendrier de fêtes républicaines, se substituant aux fêtes catholiques, ainsi que le culte de l’Être Suprême.
1795
21 février 1795
Un décret du 3 ventôse an III établit un régime de séparation des églises et de l’État. Tout en affirmant le principe du libre exercice des cultes, le décret précise que l’État n’en salarie aucun, ne fournit aucun local et ne reconnaît aucun ministre du culte.
Le concordat
15 juillet 1801
Conclusion d’un concordat avec le pape Pie VII (concordat du 26 messidor an IX) : reconnaissance du culte catholique par l’État et prise en charge d’une partie de son fonctionnement par les finances publiques en échange de la renonciation par l’Église aux biens qu’elle possédait avant la Révolution. La religion catholique n’est pas la religion officielle de la France mais celle de "la grande majorité des Français".
18 mars 1802
Adoption de la loi du 18 germinal an X sur le concordat. Bonaparte ajoute à la loi des articles organiques qui réglementent l’exercice du culte catholique en France, reconnaissent et organisent les cultes luthérien et réformé. Ces articles sont rédigés par Jean-Étienne Portalis.
17 mars 1808
Un décret organise le culte israélite sur la base d’un consistoire central et de consistoires départementaux.
15 mars 1850
Publication de la loi relative à l’enseignement ("loi Falloux") dont les principales dispositions sont les suivantes : les écoles libres peuvent tenir lieu d’écoles publiques, pour les religieux le principe de la lettre d’obédience les dispense du brevet de capacité, les communes de plus de 800 habitants sont tenues d’ouvrir une école de filles.
26 mars 1852
Création par décret du Conseil central de l’Église réformée.
28 mars 1882
La loi sur l’enseignement primaire obligatoire substitue l’éducation morale et civique à l’éducation morale et religieuse.
30 octobre 1886
La loi Goblet exclut la possibilité pour les communes de subventionner une école libre pour satisfaire à l’obligation d’entretien d’au moins une école primaire. La loi interdit tout nouveau recrutement de congréganistes dans les écoles primaires publiques.
1904
Rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège.
7 juillet 1904
Une loi sur les congrégations leur interdit d’enseigner et confisque les biens et propriétés des communautés.
La séparation des Églises et de l'État
9 décembre 1905
Loi de séparation des Églises et de l’État. L’État cesse de reconnaître, salarier et subventionner les cultes. La loi prévoit la création d’associations cultuelles "pour survenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte".2 janvier 1907
À la suite du refus de l’Église catholique de constituer des associations cultuelles qui devaient succéder aux établissements publics du culte mis en place sous le concordat, promulgation de la loi concernant l’exercice public des cultes. L’article 1er dispose : "l’État, les départements et les communes recevront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété". Les édifices affectés aux cultes sont laissés à la disposition des fidèles ; la jouissance en est confiée aux associations cultuelles.
13 avril 1908
Une nouvelle loi consacre la perte du patrimoine immobilier de l’Église catholique. Les édifices affectés au culte lors de l’adoption de la loi de 1905 sont confiés aux communes. L’article 5 de la loi établit que l’État, les départements et les communes sont également responsables de l’entretien et de la conservation de ces édifices.
17 août 1911
Un décret supprime officiellement la direction générale des cultes, remplacée par un simple bureau des cultes.
1918
À la fin de la Première Guerre mondiale, l’Alsace-Moselle, qui avait été annexée à l’Empire allemand en 1871, revient à la France. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle demeurent sous le régime concordataire de 1802 modifié par l’Empire allemand (notamment sur les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires ainsi que sur le statut des ministres des cultes).
1921
Reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Un protocole est établi pour la nomination des évêques.
Janvier 1924
Signature des Accords Briand-Cerretti entre la France et le Vatican. La République reconnaît la soumission des associations diocésaines à la hiérarchie épiscopale tout en les considérant conformes à la loi de 1905.
8 avril 1942
Une loi supprime le délit de congrégation et prévoit que toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État.
4 octobre 1946
Inscription dans la Constitution de la IVe République du principe de laïcité.
31 décembre 1959
Loi Debré sur la liberté de l’enseignement qui fixe les règles de fonctionnement et de financement (subventions) des établissements privés sous contrat.
23 novembre 1977
Décision du Conseil constitutionnel reconnaissant la liberté de l’enseignement comme un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Pendant le 19ème siècle : une montée des pensées anti-religieuses.
Au cours du XIXe siècle, les progrès de la sécularisation dans les mentalités comme dans les faits de société amènent les libéraux, les libres penseurs, les anticléricaux à soutenir avec de plus en plus de force que la religion doit se réduire à une simple option de la conscience individuelle privée, sans aucune manifestation sociale et publique.
Les Lois Ferry
Les lois Jules Ferry, votées alors que celui-ci était ministre de l’Instruction publique, participent du projet des fondateurs de la IIIe République de séculariser la société française. Elles s’inscrivent dans la lutte anticléricale menée par des hommes imprégnés par l’esprit des Lumières et par le positivisme : en enlevant à l’Église le quasi-monopole de l’éducation de la jeunesse française, Ferry espère réduire l’influence politique du catholicisme.
Une première série de lois, en mars 1879, en février et mars 1880, exclut les représentants confessionnels du Conseil supérieur de l’Instruction publique et interdit l’enseignement aux membres des congrégations non autorisées.
Les lois Jules Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et l'enseignement public laïque (1882).
La loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève les lois Jules Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, remplaçant les instituteurs congrégationalistes.
Ce texte établit également la laïcité de l’enseignement : l’instruction religieuse est supprimée des programmes pour être remplacée par l’instruction morale et civique.
En 1886 est votée la loi laïcisant le personnel enseignant dans le primaire.
Dès 1894, une nouvelle vague anticléricale déferle sur le catholicisme à l’occasion de l’affaire Dreyfus.
En 1901, la loi sur les associations est promulguée. Elle contient un ensemble de mesures discriminatoires à l’égard des Congrégations, seules associations soumises à autorisation et contrôle de L’État.
Loi de 1905 : une loi de liberté
La Loi du 1er juillet 1901 a reconnu aux citoyens français le droit de s'associer en dehors de tout contrôle de la puissance publique. Son article premier définit l'association comme " la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ".
Elle s'est inscrite dans le mouvement général d'ouverture qui a marqué la société française à la fin du siècle dernier. La période qui avait précédé sa promulgation avait vu l'affirmation des grandes libertés : loi du 29 juillet1881sur la liberté de la presse et de réunion, loi du 21 mars 1884 sur la liberté du groupement syndical.
Dans le contexte de la préparation de la séparation des Églises et de L’État (séparation qui sera instituée par la Loi du 9 décembre 1905) les dispositions relatives aux congrégations religieuses ont occupé le devant de la scène.
Les évolutions que la reconnaissance du droit d'association allait introduire, au plan général de la République et de la démocratie, expliquent également la durée des débats et l'ampleur de la bataille parlementaire qui a été menée.
1904 : Le gouvernement Combes rompt les relations diplomatiques avec le Saint Siège.
La loi du 9 décembre 1905 établit la séparation de l’Église et de L’État.
Certains députés d’extrême gauche attendent de cette loi qu’elle achève l’œuvre de déchristianisation commencée après la Révolution.
Le contenu de la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité
La loi de 1905 proclame en premier lieu la liberté de conscience : "La République assure la liberté de conscience". Elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d’exercice du culte et la non-discrimination entre les religions.
Elle pose en second lieu le principe de la séparation des Églises et de l’État : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". Il est mis fin au Concordat instauré en 1802, qui régissait les relations entre l’État et les cultes. Jusqu'alors, l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte. L’État payait les ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu’à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n’étaient pas reconnus.
L’État se veut désormais neutre. Il n’y a plus de religion légalement consacrée. Tous les cultes sont traités de manière égale.
Article 1
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules conditions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Cet article capital affirme deux principes qu’on ne peut séparer :
La liberté de conscience, dont la liberté religieuse est une des composantes, est assurée par la République. En France, nul ne peut être contraint ou empêché de croire ou de ne pas croire par qui que ce soit, et l’Etat veille au respect de cette liberté.
Le libre exercice des cultes est garanti par la République, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public. Les croyants ont donc la liberté de manifester leurs croyances dans la célébration de leur culte. Il s’agit bien de l’expression sociale et publique des opinions religieuses personnelles.
Ce premier article est équilibré puisqu’il affirme à la fois la liberté de conscience et la liberté de culte. Il est à l’origine d’un consensus acquis de nos jours.
Article 2
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte… »
Cet article met fin au Concordat de 1801.
La loi de 1905 prévoit que, dès le 1er janvier qui suit la promulgation de la loi, « seront supprimées des budgets de L’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes » à l’exception de celles qui permettent le libre exercice du culte dans les établissements publics tels que les lycées, les hospices, les prisons. C’est à la suite de cette suppression que l’Église catholique a établi le « denier du culte » pour subvenir à l’entretien du Clergé
Article 3
« Les établissements dont la suppression est ordonnée continueront provisoirement de fonctionner jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues Il sera donc prévu à l’inventaire descriptif et estimatif »
Cet article met fin également au Concordat de 1801.
Article 4
« Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements ».
Certains députés espéraient ce que d’autres redoutaient, à savoir que ces associations prendraient leurs distances par rapport à la hiérarchie ecclésiastique ; d’aucuns avaient même évoqué la possibilité de schismes. On comprend l’inquiétude des catholiques.
Le rapporteur du projet de loi, Aristide Briand, se défend d’avoir de telles arrière-pensées ; aussi accepte-t-il une modification de l’article en discussion car, dit-il, « notre premier devoir, à nous législateurs, au moment où nous sommes appelés à régler le sort des Églises dans l’esprit de neutralité où nous concevons la réforme, consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution de ces Églises ». Une incise importante est donc introduite dans le texte de l’article : les biens seront transférés « aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice » … C’est un fait que l’Église catholique a une constitution propre avec un pape, des évêques, des curés…
Cette loi de séparation est élaborée sans concertation avec le Pape Pie X qui proteste contre ce manquement aux règles du droit international.
Dans son encyclique « Vehementer nos », il condamne le principe même de la séparation et réaffirme vigoureusement la constitution hiérarchique de l’Église.
Le régime de séparation a plusieurs conséquences, prévues par la loi :
Le budget des cultes est supprimé, à l’exception de ceux relatifs aux aumôneries des lycées, des écoles, des hospices, des prisons, etc. Les aumôneries sont autorisées pour permettre le libre exercice des cultes dans les lieux publics fermés ;
Les établissements publics du culte, jusque-là chargés de la gestion des cultes, sont remplacés par des associations cultuelles, créées par loi. Ces associations doivent avoir pour unique objet l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. Leurs ressources doivent provenir de l’argent des cotisations d’adhésion, des quêtes et des collectes pour l’exercice du culte. L’Église catholique refuse toutefois de constituer ces associations, qui ne reconnaissent pas l’autorité de l’évêque. En 1923 un compromis est trouvé et des associations diocésaines, placées sous la présidence des évêques, sont constituées ;
Les règles concernant le régime de propriété des édifices cultuels sont redéfinies. Restent propriétés de l’État, des départements ou des communes, les édifices religieux qu’ils possédaient avant la loi (notamment ceux nationalisés en 1789). Les édifices religieux qui appartiennent aux établissements publics du culte sont, pour leur part, attribués aux associations cultuelles. Toutefois, devant le refus de l’Église catholique de créer de telles associations, une loi de 1907 prévoit que tous les édifices catholiques deviennent propriété publique. Ils sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Quant aux édifices postérieurs à la loi de 1905, ils sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits.
La loi traite également de la police des cultes. Elle proscrit notamment la tenue de réunions politiques dans les locaux cultuels. Elle interdit, par ailleurs, "d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit", sauf dans les cimetières et les musées. Il s’agit d’affirmer la neutralité idéologique de l’État.
Avec la loi de 1905, un nouvel équilibre est institué entre l’État, la société et les religions. « La laïcité, dont il n’est pas fait explicitement référence dans la loi, a été depuis confortée ». Elle est devenue un principe à valeur constitutionnelle avec les Constitutions du 27 octobre 1946 (IVe République) et du 4 octobre 1958 (Ve République).
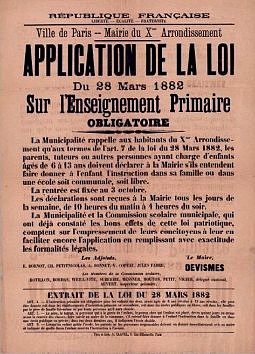 |
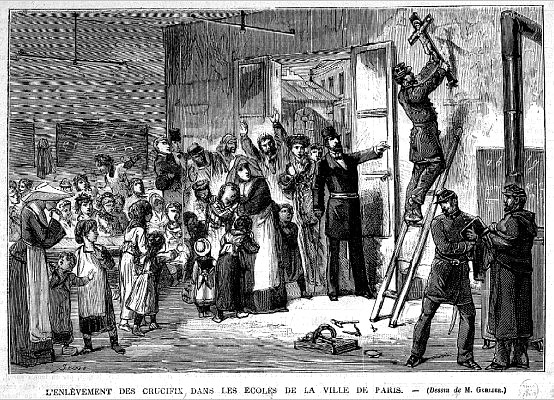 |
Laïcité et crèches de Noël
Le 9 novembre 2016, le Conseil d’État a rendu une décision sur la légalité des installations temporaires de crèches de Noël dans les bâtiments publics (mairies, etc.) eu égard au principe de laïcité.
Le Conseil d’État était saisi de deux arrêts :
Celui de la cour administrative d’appel de Paris qui interdisait toute installation de crèche de Noël au nom du principe de neutralité ;
Celui de la cour administrative d’appel de Nantes qui considérait que l’installation d’une crèche ne constituait pas un signe ou un emblème religieux.
Le Conseil a cassé ces deux arrêts considérant que :
Au nom de la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, l’installation de signes ou d’emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse est interdite ;
Les crèches de Noël peuvent cependant avoir plusieurs significations et elles ne présentent pas toujours un caractère religieux (traditions locales pour les fêtes de fin d’année, etc.).
En conséquence, le Conseil d’État juge que l’installation d’une crèche par une collectivité publique dans un bâtiment public est possible quand la crèche présente un caractère culturel, artistique ou festif. En revanche, elle est interdite si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse.
Pour déterminer le caractère culturel ou festif, le Conseil d’État tient compte du contexte et des conditions particulières de l’installation, de l’existence ou pas de traditions locales et du lieu de l’installation. Ainsi, dans un bâtiment public comme une mairie, l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Pour apprécier ces circonstances, le Conseil d'État a précisé qu'il fallait tenir compte du contexte qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l'installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux et du lieu de l'installation.
Une église stimulée
Le choc subi par le catholicisme français, que beaucoup espéraient lui être fatal, agit plutôt comme un coup de fouet. Certes, l’Église connaîtra désormais une situation financière difficile, mais ses fidèles sont ainsi conduits à se sentir plus responsables de sa survie matérielle. La condition économique et sociale du prêtre régresse, mais les motivations des vocations en sont purifiées d’autant. Enfin et surtout, l’Église jouit désormais en France d’une liberté qu’elle n’a jamais connue ; la nomination des évêques, par exemple, ne dépend plus du pouvoir. Mais, c’est là le jugement qu’il est possible de porter des années plus tard, une fois surmontés les difficiles problèmes posés par les mesures hostiles de 1905 ; à l’époque, on pouvait nourrir de légitimes inquiétudes.
La situation nouvelle alors faite à l’Église en France fait plus clairement percevoir à ses membres les changements survenus depuis la Révolution et accélère les prises de conscience nécessaires : le temps d’une société de chrétienté est révolu ; l’Église doit désormais accomplir sa mission dans un monde sécularisé et laïcisé. Mais il faudra encore du temps pour en tirer toutes les conséquences.
Dans l’immédiat, la vitalité du catholicisme français en ce début de XXe siècle se manifeste de maintes façons. A lui seul, par exemple, il fournit aux missions du monde entier les deux tiers de leurs prêtres, les quatre cinquièmes de leurs frères et religieuses, et la plus grande part de leurs ressources financières. Par ailleurs, au moment même où un climat d’intolérance se développe contre l’Église, on observe un renouveau religieux dans les milieux intellectuels où règnent le positivisme et le scientisme, renouveau attesté par des nombreuses conversions (Péguy, Claudel, Blondel, Huysmans…).
1907 : Par la loi du 28 mars 1907, le Gouvernement autorise les réunions publiques quel qu’en soit l’objet, sans déclaration préalable. Ainsi est assurée une liberté à l’exercice du culte.
La question du statut juridique du Curé n’est pas réglée.
1920 : Lors de la canonisation de Jeanne d’Arc en 1920, les liens diplomatiques avec le Saint Siège sont renoués.
1924 : Parallèlement, de nouvelles propositions sont faites pour régler la question des Associations Cultuelles. Le projet d’« Association Diocésaine » présidée par l’Evêque est jugé conforme à la loi de 1905 et est promulguée en 1924. Le Pape Pie XI autorise la formation de ces associations dans son Encyclique du 14 janvier 1924.
La jurisprudence du Conseil d’Etat fait du Curé le « gardien de son église ».
La tourmente des inventaires
Les inventaires des biens de l’Église suscitent des résistances dans certaines régions traditionalistes et catholiques, notamment l’Ouest de la France (Bretagne, Vendée), la Flandre et une partie du Massif central. Des manifestations s’y opposent, tandis qu’une circulaire de février 1906 dispose que « les agents chargés de l’inventaire demanderont l’ouverture des tabernacles », suscitant l’émotion des catholiques, pour qui cela constitue un grave sacrilège. Le 27 février 1906, des heurts ont lieu dans la commune de Monistrol-d'Allier, village de 1 000 habitants. Le 3 mars, lors de la tentative d’inventaire faite dans la commune de Montregard, 1 800 habitants, un homme, André Régis, est grièvement blessé ; il mourra le 24 mars. Le 6 mars, à Boeschepe (Nord), commune de 2 200 habitants, lors d’un autre inventaire, un paroissien, Géry Ghysel, est abattu dans l’église. Le 7 mars 1906, le cabinet Rouvier tombe sur cette question, laissant la place à Ferdinand Sarrien.
Celui-ci confie le ministère de l’Instruction publique à Briand, qui exige que Clemenceau entre dans le gouvernement afin de l’avoir avec lui plutôt que contre lui. Devenu ministre de l’Intérieur, Clemenceau, notoirement anticlérical, joue l’apaisement, mettant fin à la querelle des inventaires par une circulaire de mars 1906 invitant les préfets à suspendre les opérations d’inventaire dans les cas où elles doivent se faire par la force alors qu’il ne reste plus que 5 000 sanctuaires, sur 68 000, à inventorier.
Conséquences immédiates
Le vote et l’application de la loi de séparation ont été les dernières étapes du mouvement de laïcisation et de sécularisation engagé en 1789. Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation instaure la laïcité.
La loi du 17 avril 1906 et le décret du 4 juillet 1912 ont confié la charge des 87 cathédrales concordataires au secrétariat d’État aux Beaux-Arts, devenu ministère de la Culture et de la Communication, en raison du refus des départements de les assumer. La plupart des 67 autres existantes sont la propriété d'une commune : c'est le cas des églises construites avant 1905 et érigées en cathédrales lors de la création de nouveaux diocèses (Pontoise, 1965 ; Le Havre, 1974) ou de celles ayant perdu leur statut de siège épiscopal après la Révolution (Saint-Malo, Tréguier, Noyon, Lescar, etc.) La cathédrale d'Ajaccio est dévolue à la région Corse, devenue collectivité de Corse.
Cette propriété de l’État s’étend à l’ensemble des dépendances immobilières et à la totalité des immeubles par destination et des meubles les garnissant. Le cadre juridique de l’aménagement intérieur des cathédrales a été analysé par Pierre-Laurent Frier, professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), ancien directeur des études de l’École nationale du patrimoine ; et la compétence du conseil municipal quant aux églises et aux biens qui y ont été installés a été traitée par Marie-Christine Rouault, doyen de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Lille II à partir de l’arrêt du 4 novembre 1994 du Conseil d’État. Les édifices postérieurs à 1905 demeurent généralement propriétés des associations cultuelles, maîtres d’ouvrage lors des constructions. Afin de gérer le patrimoine mobilier des lieux de culte, les conservations des antiquités et objets d’art ont été créées dans chaque département, par le décret du 11 avril 1908.
Caractère constitutionnel de la loi de 1905
En 2006, la Commission Machelon relève que le Conseil constitutionnel a évité par deux fois de donner un statut constitutionnel à la loi de 1905 (la France étant cependant définie comme République laïque par l'article premier de la Constitution de 1958). Dans sa décision du 23 novembre 1977 (dite « loi Guermeur »), le Conseil a consacré la liberté de conscience en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République en se référant à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen et au Préambule de la Constitution de 1946, mais sans indiquer à quelle(s) loi(s) il le rattachait. De même en 2004, lors de l'examen de la compatibilité à la Constitution de l’article II-70 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, il ne se réfère pas à la loi de 1905.
Toutefois, à l'occasion de la QPC relative au concordat en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel statue en février 2013 en reprenant dans ses attendus de larges passages de la loi du 9 décembre 1905, intégrant de facto cette loi au bloc de constitutionnalité.
Outre-mer
Lors de l'avant-dernière séance de débat à l'Assemblée nationale, le 30 juin 1905, il est adopté un amendement « Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies » qui diffère l'application de la future loi hors du territoire métropolitain.
La loi de 1905 s'applique dans les départements de Guadeloupe, Martinique, et Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en vertu d'un décret du 6 février 1911. En revanche, les décrets Mandel de 1939 entérinent l'absence de séparation dans les autres territoires où ne s'applique pas la loi de 1905 : Guyane, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Mayotte.
Dans les colonies, la loi de séparation n'est pas appliquée, sauf à Madagascar, où une séparation de fait existait déjà et où le gouverneur Victor Augagneur avait durement combattu le protestantisme (considéré comme favorable à l’Angleterre et à l’autonomie des Malgaches) où le décret du 11 mars 1913 reprend les deux premiers articles de la loi de 1905, ainsi qu'au Cameroun, le décret du 28 mars 1933. En Algérie, le décret du 27 septembre 1907 imposait aux responsables des associations cultuelles d’être citoyens français, ce qui de facto soustrait l’islam à l’application de la loi de 190527. Par la circulaire Michel du 16 février 1933, l’État règlementera même le droit de prêche dans les mosquées.
Cas de l’Alsace-Moselle
L’Alsace et la Moselle n’étant pas françaises au moment de la promulgation de la loi, celles-ci ont encore aujourd’hui un statut spécial, sorte de dernier héritage du concordat : les évêques, les prêtres, les rabbins et les pasteurs y sont toujours assimilés à des fonctionnaires. L'État participe, au moins formellement, à la nomination des évêques, et paie l’entretien des bâtiments. L’enseignement religieux dans les écoles publiques est également préservé. La validité de cette exception est confirmée en février 2013 par le Conseil constitutionnel.
Garantie de la liberté des cultes
Construction et réparation d'édifices religieux
Depuis sa parution la jurisprudence a complété la loi par plus de 2 000 pages d’avis, de cours. D’après les inspecteurs généraux des affaires culturelles François Braize et Jean Petrilli, cela a largement complété et modifié la loi initiale.
La loi du 19 août 1920 (parue au Journal officiel le 21 août 1920) relative à la construction de la Grande mosquée de Paris déroge ponctuellement à la loi de 1905 en accordant pour son édification une subvention de 500 000 francs, abondée par une souscription levée auprès des Musulmans d'Afrique du Nord, la Ville de Paris décidant à l'unanimité, de faire donation perpétuelle et gratuite des terrains nécessaires.
La loi du 25 décembre 1942 (parue au Journal officiel le 2 janvier 1943) modifie l'article 19 in fine en ce sens que ne sont plus considérées comme des subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices non classés, alors qu'en 1905 ce n'était possible que pour les réparations aux monuments classés.
Sources :
Internet
Wikipédia
La Hiérarchie Catholique par Fernand Menigoz
 |
 |
Le haut clergé
Le haut clergé est un phénomène connu dans toutes les religions qu'elles soient ou non monothéistes. Une étude comparatiste intéressante pourrait élucider :
Le mode de désignation de ses membres (élection, cooptation, révélation).
Le mode de succession des responsables.
La proximité et les relations avec le pouvoir politique.
Pape
Le pape est l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique. Il est élu, après le décès ou la démission de son prédécesseur, par des cardinaux électeurs qui se réunissent en conclave pour délibérer et voter. L'autorité du pape dans l'Église se transmet par succession depuis l'apôtre saint Pierre, lui-même l'ayant reçue directement de Jésus-Christ. Cependant, la façon de concevoir et d'exercer cette autorité a évolué au cours des siècles. Le titre de pape apparaît dans des documents à partir du premier concile de Nicée en 325.
Cardinal
Un cardinal est un haut dignitaire de l'Église catholique choisi par le pape et chargé de l'assister. Il fait partie du Collège des cardinaux (anciennement appelé Sacré Collège, jusqu'en 1983). Le titre précis est cardinal de la Sainte Église romaine ; les cardinaux forment la plus haute sphère de l'Église romaine.
L'insigne distinctif des cardinaux est la couleur rouge (dite pourpre cardinalice), couleur du sénat romain, rappelant le sang versé par le Christ. C'est le pape Innocent IV, lors du premier concile de Lyon en 1245 qui donna la pourpre et le chapeau rouge aux cardinaux.
Ils portent soit la soutane rouge avec une barrette ou une calotte rouge et une mozette rouge, soit une soutane et une mozette noires avec des liserés et des boutons rouges.
Les cardinaux portent l'anneau, qui traditionnellement est de saphir et, même s'ils n'ont pas reçu la consécration épiscopale, ils utilisent la croix pectorale, la crosse et la mitre.
Archevêque
Un archevêque est un ministre religieux ordonné appartenant à l'ordre épiscopal, mais bénéficiant d'une primauté d'honneur sur les évêques suffragants. Il est à la tête d'une province ecclésiastique.
Archevêque et archidiocèse
En principe, l'archevêque est l'ordinaire d'une église particulière appelée archidiocèse. L'ordinaire d'un archidiocèse est dit archevêque ex officio.
Mais, d'une part, un archevêque peut n'être l'ordinaire que d'un simple diocèse ou d'une autre église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque ad personam.
D'autre part, un archevêque peut n'être l'ordinaire d'aucune église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque titulaire.
Archevêque primat
Certains archevêques métropolitains jouissent également du titre de primat, qui leur garantit une juridiction théorique sur plusieurs provinces. En France, seuls les titres de Primat des Gaules et de Primat de Normandie, attribués respectivement aux archevêques de Lyon et de Rouen, ont gardé des prérogatives honorifiques réelles. Les autres primaties provinciales ne sont plus portées depuis les années 1960-1970.
Archevêque patriarche
Deux archevêques métropolitains jouissent du titre de patriarche : celui de Venise, en Italie, et celui de Lisbonne, au Portugal.
Archevêque titulaire
Enfin, les archevêques ou évêques titulaires sont des prélats pourvus de la dignité épiscopale, mais n'ayant aucune juridiction diocésaine. Cette dignité est souvent accordée à des membres de la Curie romaine et aux nonces apostoliques.
Evêque
Dans la hiérarchie catholique, un évêque est un ecclésiastique qui dirige un diocèse.
Il est chargé de veiller sur son Église locale, d'assurer la liturgie, l'enseignement de la foi catholique et le service aux plus démunis. Il peut convoquer un synode diocésain pour l'aider à discerner les orientations pastorales pour son diocèse. Il est assisté dans sa tâche par des diacres et des prêtres, ou même des laïcs, dument mandatés. Ses plus proches collaborateurs étaient autrefois les archidiacres ; on les appelle aujourd'hui vicaires épiscopaux et vicaires généraux. L'évêque est également assisté de conseils presbytéraux parmi lesquels se trouve le chapitre cathédral.
Les sacrements que seuls les évêques peuvent administrer sont :
La confirmation (déléguée aux prêtres diocésains, mais l'onction est effectuée avec l'huile chrismale bénie par l'évêque).
Le sacrement de l'ordre : ordination diaconale et presbytérale, consécration épiscopale.
Il représente la continuité Apostolique, c'est le descendant des apôtres. Un diocèse en France représente généralement un département sauf exception.
Il peut-être aussi Archevêque, il dirige plusieurs diocèses en collégialité avec l'évêque du lieu.
Un évêque peut être nommé Cardinal par le Pape. C'est un titre et une charge et il a en cas de mort du Pape à participer à l'élection du successeur.
Evêque coadjuteur
Évêque adjoint à l’évêque diocésain, ayant droit de succession.
Évêque émérite
Quand un évêque atteint 75 ans, il demande à déposer la charge de son diocèse.
Quand elle est acceptée par le pape, il devient évêque émérite.
Le bas clergé
Clergé séculier
Le clergé séculier comprend les clercs et les prêtres au service de l'Église dans le cadre de l'Église diocésaine (évêques, prêtres, diacres)
Vicaire général
Un vicaire général (appelé aussi VG, autrefois grand-vicaire) est un clerc qui, muni du pouvoir exécutif ordinaire général, seconde un évêque diocésain ou tout autre Ordinaire ecclésiastique qui lui est équiparé, dans l’exercice de son gouvernement au sein du diocèse (ou d’une communauté de l’Église catholique). Dans un diocèse il est nécessairement prêtre.
Le vicaire général doit être prêtre, avoir au moins 30 ans et posséder un doctorat ou licence en droit canon ou théologie, ou faire montre d’une compétence plus qu’ordinaire dans ces sciences ecclésiastiques. S’il est évêque il est également appelé « évêque auxiliaire ».
Chanoine
Un chanoine est un membre du clergé séculier attaché au chapitre d'une église ou d'une cathédrale avec une fonction à accomplir comme l'enseignement, le secours des pauvres, la chorale, le bâtiment, etc.
Au Haut Moyen Âge, le mot pouvait désigner certains membres du personnel laïc des églises. Aujourd'hui, il existe des chanoines religieux (séculiers ou réguliers), des chanoines laïcs et des femmes religieuses régulières (chanoinesse).
Doyen
le doyen sert d’intermédiaire entre l’autorité épiscopale et le clergé de son doyenné.
Les doyens sont élus par leurs collègues du doyenné et confirmés par l’évêque. Les doyens jouent un rôle important lors de l'installation de nouveaux curés. Quand les curés présentés par les collateurs ont été examinés par l’archidiacre et agréés par l’évêque, c’est le doyen qui les conduit dans leur paroisse, convoque les fidèles au son de la cloche et procède à leur installation. Il doit ensuite veiller sur eux, visiter les églises, les chapelles, les cimetières.
Pour les aider dans leurs fonctions, les doyens ruraux ont un ou plusieurs échevins, choisis également par les prêtres du doyenné parmi leurs collègues.
C’est encore à lui d’administrer les derniers sacrements aux prêtres de son doyenné et de les conduire à leur dernière demeure.
Archiprêtre :
Titre Honorifique accordé dans certains diocèses aux curés de chef d'arrondissement et des églises cathédrales ou anciennement cathédrales.
Curé
Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a « charge d'âmes » d'une paroisse Il est nommé par un évêque, dont il est le représentant et le délégué dans la paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent.
Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou prêtres habitués.
Le mot curé vient du latin « chargé des âmes » des paroissiens, il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens. En breton, le respect pour son autorité était encore plus net : on disait mot-à-mot le « seigneur personnage ». Les recteurs bretons se comportaient effectivement en maîtres de leur paroisse ».
Un curé est donné à une paroisse où il a charge d'appliquer la pastorale de l'ordinaire du lieu c'est à dire l'Evêque. Il est donc pasteur des fidèles de sa paroisse.
Il peut être aidé par des diacres ou d'autres prêtres que l'on appelle "Vicaires".
Un curé peut aussi être Doyen c'est à dire qu'il a en charge un doyenné ce qui équivaut à plusieurs paroisses qui ont elles-mêmes un curé. Le Doyen est élu par ses pairs.
Un curé peut-être aussi "Vicaire Apostolique". Il est un des bras de l'Evêque, il assume la direction d'un Vicariat ou d'un secteur. Il est le représentant de l'Evêque vers les curés, les prêtres et les diacres.
Un curé ou un prêtre peut être « Vicaire Général". C'est le bras droit de l'Evêque et son remplaçant temporaire en cas de départ de l'évêque du lieu.
Recteur prêtre
Dans la religion catholique, un recteur est un clerc qui a la responsabilité d'une basilique comme la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, de sanctuaires comme les sanctuaires de Lourdes, ou encore d'un établissement d'enseignement.
Dans certaines régions, notamment en Bretagne, c'est le titre usuel donné au curé d'une paroisse1. « En français, on dit « Monsieur le Curé », qui vient du latin curatus animarum : « chargé des âmes » des paroissiens), il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens.
Chapelain prêtre
Dans l'Église catholique, un chapelain, ou aumônier, est un prêtre chargé d'une chapelle ou d'une « paroisse personnelle » : maison noble, couvent ou monastère, communauté linguistique, institution particulière (école, hôpital, prison, etc.), mouvement religieux ou de jeunesse, unité militaire, etc. Il n'administre pas de territoire géographiquement déterminé et il lui est interdit d'intervenir dans le gouvernement ou administration de l'institution ou mouvement où il assume son ministère sacerdotal. Sa responsabilité se limitant aux besoins spirituels et pastoraux des fidèles dont il a la charge.
Aumônier
L'aumônier est un personnage ecclésiastique, chargé, d'une part, de distribuer l'aumône aux pauvres, et d'autre part, d'assurer les services liturgiques. France, le titre d'aumônier est également donné de nos jours à des laïcs chargés d'une mission pastorale : aumôniers laïcs de lycée, d'hôpital, de prison, ou aumôniers militaires.
Abbé
Un abbé, du latin abbas, est tout d'abord un moine chrétien élu par ses pairs pour diriger un monastère, une abbaye ou une communauté canoniale. Il s'agit là de celui qui dirige une communauté régulière. L'image de l'abbé, comme « représentant du Christ » et « père de la communauté » est très largement influencée par la règle de Saint-Benoît (chap. 2). Le terme peut désigner aussi un abbé séculier. Par extension, il s'applique également aux dirigeants de communautés monastiques d'autres traditions religieuses telles que le bouddhisme.
Abbé régulier
Anciennement, les abbés réguliers devaient avoir au moins vingt-trois ans (vingt-cinq s'ils étaient électifs), être de naissance légitime, avoir fait profession dans l'ordre. Aujourd'hui, ils doivent généralement, pour pouvoir être élus, être prêtre et avoir fait profession religieuse perpétuelle (ou vœux solennels) depuis sept ans. Ils administrent le temporel du monastère, reçoivent les religieux lors de leur profession solennelle, leur donnent la tonsure. Autrefois, ils leur conféraient les bénéfices dont le monastère avait la collation. Ils ont sur leurs religieux un droit de juridiction, une autorité qu'il leur est recommandé de n'exercer que par la voie de la patience et de la douceur. Les moines le désignent généralement sous le nom de « père abbé ». Sa titulature est Très Révérend Père (TRP).
Un religieux a contre les éventuels abus de pouvoir de son supérieur un droit d'appel auprès du procureur général de l'ordre, et jusqu'au Saint-Siège.
Abbé mitré
Ce terme désigne un abbé, dont le pouvoir d'ordre et de juridiction a été solennellement reconnu par la bénédiction abbatiale conférée par un évêque mandaté par le Saint-Siège. L’abbé élu obtient alors le droit de porter certains insignes épiscopaux : mitre (d’où son nom), crosse (insigne de juridiction, pasteur) et anneau (lien avec l’Église). À noter que les abbés mitrés, qui ont eu la bénédiction abbatiale, peuvent célébrer une messe pontificale comme un évêque sacré.
Abbé nullius diœceseis
Un abbé nullius est un abbé mitré qui a en outre la juridiction épiscopale sur un territoire. Un exemple aussi célèbre qu'exceptionnel est celui d'Héloïse. Cette pratique, autrefois courante dans les pays de mission dans lesquels l'abbaye était la seule présence ecclésiale, est tombée en désuétude depuis le Concile Vatican II, en faveur de l'érection de nouveaux diocèses. Il reste aujourd'hui onze abbayes territoriales.
Abbé laïc
Les carolingiens créèrent des abbés laïcs : laïcs titulaires de droits sur une abbaye, et qui ne sont donc pas des religieux. Par exemple, Guillaume le Pieux l'est de la Basilique Saint-Julien de Brioude. Hugues Capet fut abbé laïc des abbayes de Saint-Martin de Tours et Saint-Denis. Il doit d'ailleurs son surnom à la chape d’abbé qu’il portait fréquemment. Pour des raisons similaires, l’oncle maternel de son grand-père (Robert Ier) était dénommé Hugues l’Abbé. Lorsqu’un abbé laïc était nommé dans une abbaye, celle-ci était en fait dirigée par le prévôt.
Les abbés laïcs ont toutefois disparu depuis les réformes du concile de Trente.
Abbé commendataire
Les abbés commendataires formaient un système semblable aux abbés laïcs : François Ier, après le concordat de Bologne de 1516 établit ce système en France. Les abbés commendataires ont possédé la plupart des abbayes françaises jusqu’en 1790.
Abbesse
Équivalent féminin des abbés, les abbesses ont dans leurs monastères la même autorité que les abbés dans le leur, sauf les fonctions de la prêtrise. L’abbesse de Notre-Dame-de-Jouarre, du diocèse de Meaux, eut jusqu’en 1692, date à laquelle cette prérogative lui fut retirée à la demande de Bossuet, la juridiction épiscopale sur ses religieuses. Elle l’avait aussi sur les religieux qui dépendaient de son abbaye et approuvait les prêtres pour la confession sacramentelle.
Abbé-chancelier
Le terme abbé-chancelier est souvent abrégé en abbé ch.
Abbé séculier
Jusqu'au XVIIIe siècle les clercs séculiers étaient appelés monsieur. Depuis, il est entré dans la coutume de les appeler abbé : c'est ainsi que les abbés de cour sont des clercs séculiers pas forcément prêtres d'ailleurs. La tonsure, signe de l'entrée dans l'état ecclésiastique, est suffisante pour cette appellation. La titulature normale de tout clerc séculier (séminariste admis, diacre ou prêtre) est monsieur l'abbé, même si certaines fonctions peuvent primer : monsieur l'abbé Vianney, curé d'Ars, est ainsi appelé par ses paroissiens monsieur le curé. Depuis les années 1970, cette appellation a tendance à laisser la place, dans l'usage actuel, à l'emploi de Mon Père, ce qui est parfaitement synonyme, mais qui est restreint aux prêtres. Ce terme est ainsi employé pour les nominations décidées par l'évêque dans son diocèse ; exemple : « M. l’Abbé…. Est nommé curé /vicaire /autre(s) de… » ou bien « M. l’Abbé…. Est déchargé de ses fonctions de...... et est nommé / se retirera pour prendre sa retraite.... (/ prendra un congé / une année sabbatique) ».
Diacre
Le diacre ( « serviteur ») est une personne ayant reçu le premier degré du sacrement de l'ordre dans l'Église catholique romaine. Alors que les prêtres, qui ont reçu le second degré du sacrement de l'ordre, sont les collaborateurs de l'évêque dans son caractère sacerdotal, le diacre est collaborateur de l'évêque dans son caractère ministériel.
Le diacre permanent. Qui est appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, il ne sera jamais prêtre car il est généralement marié et souvent a une nombreuse famille. Il est destiné à être témoin de l'Eglise dans le monde c'est à dire le plus souvent dans son travail et ses lieux de vie. Il ne dépend que de l'Evêque mais doit s'entendre avec les prêtres et les curés pour la bonne marche de l'Eglise.
Le diacre en vue du presbytérat. Qui lui est aussi au moment de son ordination par l'évêque appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, mais lui se destine à la prêtrise. Il est donc célibataire et le restera. Il finit ses études et son séminaire, aide généralement un curé sur une paroisse et sera ordonné prêtre l'année suivante.
Vicaire
Du latin vicarius : suppléant, assistant
Au sens habituel le mot est utilisé pour désigner, dans une paroisse, le collaborateur du curé.
Vicaire apostolique
Prélat, représentant du Saint Siège, avec les pouvoirs d’un évêque, sans en avoir le titre parce que le territoire qu’il administre (vicariat apostolique) n’est pas encore érigé en diocèse.
qui lui est équiparé, dans l’exercice de son gouvernement au sein du diocèse (ou d’une communauté de l’Église catholique). Dans un diocèse il est nécessairement prêtre.
Religieuses
Une religieuse, moniale, ou nonne, aussi appelée « sœur » ou familièrement « bonne sœur », est une femme membre d'une communauté religieuse féminine, devant généralement obéir aux vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Elle choisit de consacrer sa vie au service des autres (sœur apostolique) ou de quitter la société afin de vivre une vie de prière et de contemplation (moniale ou sœur contemplative) tournée vers Dieu dans un monastère ou un couvent.
Quelques différentes congrégations :
L'ordre de l'Annonciation de la Vierge Marie (les Annonciade)
L'ordre de l'Annonciation céleste (les Célestes)
L’ordre du Carmel (les Carmélites)
L’ordre des Carmélites déchaussées
L’ordre de l'Immaculée Conception
L’ordre des Pauvres Dames
L’ordre des Clarisses capucines
L’ordre de Saint-Jérôme
L’ordre de Sainte-Ursule
L’ordre de la Visitation de Sainte Marie
Les Carmélites de Saint Joseph
Moines
Un moine, ou une moniale (« homme solitaire »), est un homme ou une femme, lié par des vœux de religion et menant, en solitaire ou en communauté, une vie essentiellement spirituelle
Quelques différents ordres
Les Bénédictins
Le Carmel
Les Cisterciens
Les Dominicains
Les Franciscains
Les Jésuites (ou la compagnie de Jésus)
François de Sales, Jeanne de Chantal et les visitandines
Saint Vincent de Paul, les lazaristes
Saint Augustin, les augustins
Les Communautés nouvelles
Les Lois de l'hospitalité
Le clergé séculier
Le clergé séculier est le clergé qui vit « dans le « siècle » » au milieu des laïcs, par opposition au clergé régulier qui vit « selon une « règle » de vie » d’un ordre, d'une abbaye, d'un couvent, d'un prieuré.
Les membres du clergé séculier ont pris des engagements religieux, mais leur principale caractéristique est d'être engagés dans la vie séculière et non en communauté. Le terme clergé séculier regroupe généralement les prêtres, les chanoines, etc. .
Les églises Chrétiennes
Les filiations des confessions chrétiennes
La Hiérarchie Catholique par Fernand Menigoz
 |
 |
 |
Le haut clergé
Le haut clergé est un phénomène connu dans toutes les religions qu'elles soient ou non monothéistes. Une étude comparatiste intéressante pourrait élucider :
Le mode de désignation de ses membres (élection, cooptation, révélation).
Le mode de succession des responsables.
La proximité et les relations avec le pouvoir politique.
Pape
Le pape est l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique. Il est élu, après le décès ou la démission de son prédécesseur, par des cardinaux électeurs qui se réunissent en conclave pour délibérer et voter. L'autorité du pape dans l'Église se transmet par succession depuis l'apôtre saint Pierre, lui-même l'ayant reçue directement de Jésus-Christ. Cependant, la façon de concevoir et d'exercer cette autorité a évolué au cours des siècles. Le titre de pape apparaît dans des documents à partir du premier concile de Nicée en 325.
Cardinal
Un cardinal est un haut dignitaire de l'Église catholique choisi par le pape et chargé de l'assister. Il fait partie du Collège des cardinaux (anciennement appelé Sacré Collège, jusqu'en 1983). Le titre précis est cardinal de la Sainte Église romaine ; les cardinaux forment la plus haute sphère de l'Église romaine.
L'insigne distinctif des cardinaux est la couleur rouge (dite pourpre cardinalice), couleur du sénat romain, rappelant le sang versé par le Christ. C'est le pape Innocent IV, lors du premier concile de Lyon en 1245 qui donna la pourpre et le chapeau rouge aux cardinaux.
Ils portent soit la soutane rouge avec une barrette ou une calotte rouge et une mozette rouge, soit une soutane et une mozette noires avec des liserés et des boutons rouges.
Les cardinaux portent l'anneau, qui traditionnellement est de saphir et, même s'ils n'ont pas reçu la consécration épiscopale, ils utilisent la croix pectorale, la crosse et la mitre.
Archevêque
Un archevêque est un ministre religieux ordonné appartenant à l'ordre épiscopal, mais bénéficiant d'une primauté d'honneur sur les évêques suffragants. Il est à la tête d'une province ecclésiastique.
Archevêque et archidiocèse
En principe, l'archevêque est l'ordinaire d'une église particulière appelée archidiocèse. L'ordinaire d'un archidiocèse est dit archevêque ex officio.
Mais, d'une part, un archevêque peut n'être l'ordinaire que d'un simple diocèse ou d'une autre église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque ad personam.
D'autre part, un archevêque peut n'être l'ordinaire d'aucune église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque titulaire.
Archevêque primat
Certains archevêques métropolitains jouissent également du titre de primat, qui leur garantit une juridiction théorique sur plusieurs provinces. En France, seuls les titres de Primat des Gaules et de Primat de Normandie, attribués respectivement aux archevêques de Lyon et de Rouen, ont gardé des prérogatives honorifiques réelles. Les autres primaties provinciales ne sont plus portées depuis les années 1960-1970.
Archevêque patriarche
Deux archevêques métropolitains jouissent du titre de patriarche : celui de Venise, en Italie, et celui de Lisbonne, au Portugal.
Archevêque titulaire
Enfin, les archevêques ou évêques titulaires sont des prélats pourvus de la dignité épiscopale, mais n'ayant aucune juridiction diocésaine. Cette dignité est souvent accordée à des membres de la Curie romaine et aux nonces apostoliques.
Evêque
Dans la hiérarchie catholique, un évêque est un ecclésiastique qui dirige un diocèse.
Il est chargé de veiller sur son Église locale, d'assurer la liturgie, l'enseignement de la foi catholique et le service aux plus démunis. Il peut convoquer un synode diocésain pour l'aider à discerner les orientations pastorales pour son diocèse. Il est assisté dans sa tâche par des diacres et des prêtres, ou même des laïcs, dument mandatés. Ses plus proches collaborateurs étaient autrefois les archidiacres ; on les appelle aujourd'hui vicaires épiscopaux et vicaires généraux. L'évêque est également assisté de conseils presbytéraux parmi lesquels se trouve le chapitre cathédral.
Les sacrements que seuls les évêques peuvent administrer sont :
La confirmation (déléguée aux prêtres diocésains, mais l'onction est effectuée avec l'huile chrismale bénie par l'évêque).
Le sacrement de l'ordre : ordination diaconale et presbytérale, consécration épiscopale.
Il représente la continuité Apostolique, c'est le descendant des apôtres. Un diocèse en France représente généralement un département sauf exception.
Il peut-être aussi Archevêque, il dirige plusieurs diocèses en collégialité avec l'évêque du lieu.
Un évêque peut être nommé Cardinal par le Pape. C'est un titre et une charge et il a en cas de mort du Pape à participer à l'élection du successeur.
Evêque coadjuteur
Évêque adjoint à l’évêque diocésain, ayant droit de succession.
Évêque émérite
Quand un évêque atteint 75 ans, il demande à déposer la charge de son diocèse.
Quand elle est acceptée par le pape, il devient évêque émérite.
Le bas clergé
Clergé séculier
Le clergé séculier comprend les clercs et les prêtres au service de l'Église dans le cadre de l'Église diocésaine (évêques, prêtres, diacres)
Vicaire général
Un vicaire général (appelé aussi VG, autrefois grand-vicaire) est un clerc qui, muni du pouvoir exécutif ordinaire général, seconde un évêque diocésain ou tout autre Ordinaire ecclésiastique qui lui est équiparé, dans l’exercice de son gouvernement au sein du diocèse (ou d’une communauté de l’Église catholique). Dans un diocèse il est nécessairement prêtre.
Le vicaire général doit être prêtre, avoir au moins 30 ans et posséder un doctorat ou licence en droit canon ou théologie, ou faire montre d’une compétence plus qu’ordinaire dans ces sciences ecclésiastiques. S’il est évêque il est également appelé « évêque auxiliaire ».
Chanoine
Un chanoine est un membre du clergé séculier attaché au chapitre d'une église ou d'une cathédrale avec une fonction à accomplir comme l'enseignement, le secours des pauvres, la chorale, le bâtiment, etc.
Au Haut Moyen Âge, le mot pouvait désigner certains membres du personnel laïc des églises. Aujourd'hui, il existe des chanoines religieux (séculiers ou réguliers), des chanoines laïcs et des femmes religieuses régulières (chanoinesse).
Doyen
le doyen sert d’intermédiaire entre l’autorité épiscopale et le clergé de son doyenné.
Les doyens sont élus par leurs collègues du doyenné et confirmés par l’évêque. Les doyens jouent un rôle important lors de l'installation de nouveaux curés. Quand les curés présentés par les collateurs ont été examinés par l’archidiacre et agréés par l’évêque, c’est le doyen qui les conduit dans leur paroisse, convoque les fidèles au son de la cloche et procède à leur installation. Il doit ensuite veiller sur eux, visiter les églises, les chapelles, les cimetières.
Pour les aider dans leurs fonctions, les doyens ruraux ont un ou plusieurs échevins, choisis également par les prêtres du doyenné parmi leurs collègues.
C’est encore à lui d’administrer les derniers sacrements aux prêtres de son doyenné et de les conduire à leur dernière demeure.
Archiprêtre :
Titre Honorifique accordé dans certains diocèses aux curés de chef d'arrondissement et des églises cathédrales ou anciennement cathédrales.
Curé
Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a « charge d'âmes » d'une paroisse Il est nommé par un évêque, dont il est le représentant et le délégué dans la paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent.
Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou prêtres habitués.
Le mot curé vient du latin « chargé des âmes » des paroissiens, il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens. En breton, le respect pour son autorité était encore plus net : on disait mot-à-mot le « seigneur personnage ». Les recteurs bretons se comportaient effectivement en maîtres de leur paroisse ».
Un curé est donné à une paroisse où il a charge d'appliquer la pastorale de l'ordinaire du lieu c'est à dire l'Evêque. Il est donc pasteur des fidèles de sa paroisse.
Il peut être aidé par des diacres ou d'autres prêtres que l'on appelle "Vicaires".
Un curé peut aussi être Doyen c'est à dire qu'il a en charge un doyenné ce qui équivaut à plusieurs paroisses qui ont elles-mêmes un curé. Le Doyen est élu par ses pairs.
Un curé peut-être aussi "Vicaire Apostolique". Il est un des bras de l'Evêque, il assume la direction d'un Vicariat ou d'un secteur. Il est le représentant de l'Evêque vers les curés, les prêtres et les diacres.
Un curé ou un prêtre peut être « Vicaire Général". C'est le bras droit de l'Evêque et son remplaçant temporaire en cas de départ de l'évêque du lieu.
Recteur prêtre
Dans la religion catholique, un recteur est un clerc qui a la responsabilité d'une basilique comme la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, de sanctuaires comme les sanctuaires de Lourdes, ou encore d'un établissement d'enseignement.
Dans certaines régions, notamment en Bretagne, c'est le titre usuel donné au curé d'une paroisse1. « En français, on dit « Monsieur le Curé », qui vient du latin curatus animarum : « chargé des âmes » des paroissiens), il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens.
Chapelain prêtre
Dans l'Église catholique, un chapelain, ou aumônier, est un prêtre chargé d'une chapelle ou d'une « paroisse personnelle » : maison noble, couvent ou monastère, communauté linguistique, institution particulière (école, hôpital, prison, etc.), mouvement religieux ou de jeunesse, unité militaire, etc. Il n'administre pas de territoire géographiquement déterminé et il lui est interdit d'intervenir dans le gouvernement ou administration de l'institution ou mouvement où il assume son ministère sacerdotal. Sa responsabilité se limitant aux besoins spirituels et pastoraux des fidèles dont il a la charge.
Aumônier
L'aumônier est un personnage ecclésiastique, chargé, d'une part, de distribuer l'aumône aux pauvres, et d'autre part, d'assurer les services liturgiques. France, le titre d'aumônier est également donné de nos jours à des laïcs chargés d'une mission pastorale : aumôniers laïcs de lycée, d'hôpital, de prison, ou aumôniers militaires.
Abbé
Un abbé, du latin abbas, est tout d'abord un moine chrétien élu par ses pairs pour diriger un monastère, une abbaye ou une communauté canoniale. Il s'agit là de celui qui dirige une communauté régulière. L'image de l'abbé, comme « représentant du Christ » et « père de la communauté » est très largement influencée par la règle de Saint-Benoît (chap. 2). Le terme peut désigner aussi un abbé séculier. Par extension, il s'applique également aux dirigeants de communautés monastiques d'autres traditions religieuses telles que le bouddhisme.
Abbé régulier
Anciennement, les abbés réguliers devaient avoir au moins vingt-trois ans (vingt-cinq s'ils étaient électifs), être de naissance légitime, avoir fait profession dans l'ordre. Aujourd'hui, ils doivent généralement, pour pouvoir être élus, être prêtre et avoir fait profession religieuse perpétuelle (ou vœux solennels) depuis sept ans. Ils administrent le temporel du monastère, reçoivent les religieux lors de leur profession solennelle, leur donnent la tonsure. Autrefois, ils leur conféraient les bénéfices dont le monastère avait la collation. Ils ont sur leurs religieux un droit de juridiction, une autorité qu'il leur est recommandé de n'exercer que par la voie de la patience et de la douceur. Les moines le désignent généralement sous le nom de « père abbé ». Sa titulature est Très Révérend Père (TRP).
Un religieux a contre les éventuels abus de pouvoir de son supérieur un droit d'appel auprès du procureur général de l'ordre, et jusqu'au Saint-Siège.
Abbé mitré
Ce terme désigne un abbé, dont le pouvoir d'ordre et de juridiction a été solennellement reconnu par la bénédiction abbatiale conférée par un évêque mandaté par le Saint-Siège. L’abbé élu obtient alors le droit de porter certains insignes épiscopaux : mitre (d’où son nom), crosse (insigne de juridiction, pasteur) et anneau (lien avec l’Église). À noter que les abbés mitrés, qui ont eu la bénédiction abbatiale, peuvent célébrer une messe pontificale comme un évêque sacré.
Abbé nullius diœceseis
Un abbé nullius est un abbé mitré qui a en outre la juridiction épiscopale sur un territoire. Un exemple aussi célèbre qu'exceptionnel est celui d'Héloïse. Cette pratique, autrefois courante dans les pays de mission dans lesquels l'abbaye était la seule présence ecclésiale, est tombée en désuétude depuis le Concile Vatican II, en faveur de l'érection de nouveaux diocèses. Il reste aujourd'hui onze abbayes territoriales.
Abbé laïc
Les carolingiens créèrent des abbés laïcs : laïcs titulaires de droits sur une abbaye, et qui ne sont donc pas des religieux. Par exemple, Guillaume le Pieux l'est de la Basilique Saint-Julien de Brioude. Hugues Capet fut abbé laïc des abbayes de Saint-Martin de Tours et Saint-Denis. Il doit d'ailleurs son surnom à la chape d’abbé qu’il portait fréquemment. Pour des raisons similaires, l’oncle maternel de son grand-père (Robert Ier) était dénommé Hugues l’Abbé. Lorsqu’un abbé laïc était nommé dans une abbaye, celle-ci était en fait dirigée par le prévôt.
Les abbés laïcs ont toutefois disparu depuis les réformes du concile de Trente.
Abbé commendataire
Les abbés commendataires formaient un système semblable aux abbés laïcs : François Ier, après le concordat de Bologne de 1516 établit ce système en France. Les abbés commendataires ont possédé la plupart des abbayes françaises jusqu’en 1790.
Abbesse
Équivalent féminin des abbés, les abbesses ont dans leurs monastères la même autorité que les abbés dans le leur, sauf les fonctions de la prêtrise. L’abbesse de Notre-Dame-de-Jouarre, du diocèse de Meaux, eut jusqu’en 1692, date à laquelle cette prérogative lui fut retirée à la demande de Bossuet, la juridiction épiscopale sur ses religieuses. Elle l’avait aussi sur les religieux qui dépendaient de son abbaye et approuvait les prêtres pour la confession sacramentelle.
Abbé-chancelier
Le terme abbé-chancelier est souvent abrégé en abbé ch.
Abbé séculier
Jusqu'au XVIIIe siècle les clercs séculiers étaient appelés monsieur. Depuis, il est entré dans la coutume de les appeler abbé : c'est ainsi que les abbés de cour sont des clercs séculiers pas forcément prêtres d'ailleurs. La tonsure, signe de l'entrée dans l'état ecclésiastique, est suffisante pour cette appellation. La titulature normale de tout clerc séculier (séminariste admis, diacre ou prêtre) est monsieur l'abbé, même si certaines fonctions peuvent primer : monsieur l'abbé Vianney, curé d'Ars, est ainsi appelé par ses paroissiens monsieur le curé. Depuis les années 1970, cette appellation a tendance à laisser la place, dans l'usage actuel, à l'emploi de Mon Père, ce qui est parfaitement synonyme, mais qui est restreint aux prêtres. Ce terme est ainsi employé pour les nominations décidées par l'évêque dans son diocèse ; exemple : « M. l’Abbé…. Est nommé curé /vicaire /autre(s) de… » ou bien « M. l’Abbé…. Est déchargé de ses fonctions de...... et est nommé / se retirera pour prendre sa retraite.... (/ prendra un congé / une année sabbatique) ».
Diacre
Le diacre ( « serviteur ») est une personne ayant reçu le premier degré du sacrement de l'ordre dans l'Église catholique romaine. Alors que les prêtres, qui ont reçu le second degré du sacrement de l'ordre, sont les collaborateurs de l'évêque dans son caractère sacerdotal, le diacre est collaborateur de l'évêque dans son caractère ministériel.
Le diacre permanent. Qui est appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, il ne sera jamais prêtre car il est généralement marié et souvent a une nombreuse famille. Il est destiné à être témoin de l'Eglise dans le monde c'est à dire le plus souvent dans son travail et ses lieux de vie. Il ne dépend que de l'Evêque mais doit s'entendre avec les prêtres et les curés pour la bonne marche de l'Eglise.
Le diacre en vue du presbytérat. Qui lui est aussi au moment de son ordination par l'évêque appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, mais lui se destine à la prêtrise. Il est donc célibataire et le restera. Il finit ses études et son séminaire, aide généralement un curé sur une paroisse et sera ordonné prêtre l'année suivante.
Vicaire
Du latin vicarius : suppléant, assistant
Au sens habituel le mot est utilisé pour désigner, dans une paroisse, le collaborateur du curé.
Vicaire apostolique
Prélat, représentant du Saint Siège, avec les pouvoirs d’un évêque, sans en avoir le titre parce que le territoire qu’il administre (vicariat apostolique) n’est pas encore érigé en diocèse.
qui lui est équiparé, dans l’exercice de son gouvernement au sein du diocèse (ou d’une communauté de l’Église catholique). Dans un diocèse il est nécessairement prêtre.
Religieuses
Une religieuse, moniale, ou nonne, aussi appelée « sœur » ou familièrement « bonne sœur », est une femme membre d'une communauté religieuse féminine, devant généralement obéir aux vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Elle choisit de consacrer sa vie au service des autres (sœur apostolique) ou de quitter la société afin de vivre une vie de prière et de contemplation (moniale ou sœur contemplative) tournée vers Dieu dans un monastère ou un couvent.
Quelques différentes congrégations :
L'ordre de l'Annonciation de la Vierge Marie (les Annonciade)
L'ordre de l'Annonciation céleste (les Célestes)
L’ordre du Carmel (les Carmélites)
L’ordre des Carmélites déchaussées
L’ordre de l'Immaculée Conception
L’ordre des Pauvres Dames
L’ordre des Clarisses capucines
L’ordre de Saint-Jérôme
L’ordre de Sainte-Ursule
L’ordre de la Visitation de Sainte Marie
Les Carmélites de Saint Joseph
Moines
Un moine, ou une moniale (« homme solitaire »), est un homme ou une femme, lié par des vœux de religion et menant, en solitaire ou en communauté, une vie essentiellement spirituelle
Quelques différents ordres
Les Bénédictins
Le Carmel
Les Cisterciens
Les Dominicains
Les Franciscains
Les Jésuites (ou la compagnie de Jésus)
François de Sales, Jeanne de Chantal et les visitandines
Saint Vincent de Paul, les lazaristes
Saint Augustin, les augustins
Les Communautés nouvelles
Les Lois de l'hospitalité
Le clergé séculier
Le clergé séculier est le clergé qui vit « dans le « siècle » » au milieu des laïcs, par opposition au clergé régulier qui vit « selon une « règle » de vie » d’un ordre, d'une abbaye, d'un couvent, d'un prieuré.
Les membres du clergé séculier ont pris des engagements religieux, mais leur principale caractéristique est d'être engagés dans la vie séculière et non en communauté. Le terme clergé séculier regroupe généralement les prêtres, les chanoines, etc. .
Les églises Chrétiennes
Les filiations des confessions chrétiennes
GLOSSAIRE TERMES RELIGIEUX CATHOLIQUES Par Fernand Menigoz
Définition de quelques termes religieux :
Abbaye :
Une abbaye est un monastère de moines ou moniales catholiques placé sous la direction d'un abbé — « père » en araméen — ou d'une abbesse, l'abbé étant le supérieur tout en étant « père spirituel » de la communauté religieuse, suivant les indications données au chapitre 2 de la règle de saint Benoît (du moins dans le monachisme occidental).
Ambon :
Podium ou pupitre surélevé, placé à l’entrée du chœur d’une église. De l’ambon est proclamée la Parole de Dieu. Il est aussi utilisé pour la prédication.
Anachorète :
Religieux, retiré dans la solitude, la montagne, le désert (en opposition avec le cénobite).
Anathème :
Du latin anathema. Excommunication majeure prononcée contre les hérétiques ou les ennemis de la foi catholique.
Augustin :
Moine vivant selon la règle définie par l'évêque d'Hippone, dans sa lettre " Regula ad servos Dei" aux moniales de sa ville, qui guidera notamment chanoines, ermites et moines.
Aumônerie :
Service d’Église qui assure une présence chrétienne dans un ensemble pastoral précis : Lycées, Hôpitaux, Action Catholique, Prison.
Autel :
Dans la Bible, table de pierre dressée pour rappeler une intervention divine. Des sacrifices y étaient parfois offerts (animaux, libations). Dans l’Église catholique, l’autel est l’endroit le plus sacré de l’église, où l’on célèbre l’Eucharistie ; il a généralement la forme d’une table.
Baptistère :
Le baptistère est le lieu du baptême. Dans le haut Moyen Âge, le baptistère était un bâtiment totalement extérieur à l'église.
Basilique :Dans l'Église catholique romaine, une basilique est une église jouissant d'un privilège. Ce terme est un titre honorifique donné par le pape à une église où de nombreux fidèles viennent spécialement en pèlerinage pour prier Jésus-Christ, la Vierge Marie ou encore les reliques d'un saint particulièrement vénéré. Par cette distinction honorifique, les basiliques ont préséance sur toutes les autres églises, à l'exception de la cathédrale de leur diocèse.On distingue les basiliques majeures (quatre églises de Rome) et les basiliques mineures. Les basiliques majeures et certaines basiliques mineures possèdent depuis des temps très lointains le titre de basilique et les privilèges qui y sont attachés. Les autres basiliques doivent leur titre et leurs privilèges à une décision du pape.Par extension, certaines églises remarquables sont également appelées basiliques (par exemple Sainte-Sophie à Constantinople). Cependant cette dénomination peut prêter à confusion entre le plan architectural classique de la basilique (plan basilical), le titre attribué par la papauté et cette extension.Le responsable (curé) d'une basilique porte le titre de recteur ou de recteur-archiprêtre si la basilique est également une cathédrale. Certains recteurs ne sont pas placés sous l'autorité d'un évêque. C'est le cas notamment de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre qui dépend directement de la Conférence des évêques de France et du pape, non de l’archevêque de Paris.
Bénédictin :
Mot qui remonte au 13 s. pour désigner les moines de Cluny. Religieux appartenant l'Ordre de saint Saint-Benoît, par opposition aux moines blancs de l'Ordre de Cîteaux.
Bénitier :
Vasque disposée à l’entrée de l’église contenant l’eau bénite. En entrant dans l’église, les fidèles se signent, (font le signe de croix) après avoir trempé le bout des doigts dans l’eau du bénitier. L’eau bénite est un des sacramentaux.
Bernardin :
Religieux cistercien qui, à l'origine, allait étudier au collège " Saint Bernard " à Paris.
Bible :
La Bible raconte l’histoire de l’alliance que Dieu a scellée avec les hommes. Pour les chrétiens la Bible, c’est la Parole de Dieu : ils croient que Dieu est quelqu’un qui peut communiquer avec eux. Dieu s’est révélé à Israël par Moïse et les prophètes et pour les chrétiens, par Jésus le Christ. Elle témoigne des relations entre les hommes et Dieu : relation faite de fidélité et de reniement. C’est un long cheminement vers la liberté et l’amour.
Sacrée pour les chrétiens et les juifs, la Bible porte un nom qui n'a rien de religieux. En effet, son origine est géographique et fait référence à la cité portuaire de Byblos, au Liban.
La majorité s'accordent pour situer son écriture entre les VIII e et II e siècle av. J. -C., et celle du Nouveau Testament entre le milieu du I er et le début du II e siècle. Le plus ancien objet sur lequel on retrouve un texte biblique est l'amulette de Ketef Hinnom, datée vers 600 av.
Les versets
Trois siècles plus tard, au milieu du XVIe siècle, le célèbre imprimeur et humaniste français Robert Estienne a rendu les choses encore plus faciles. Il voulait rendre l’étude de la Bible plus accessible. Il a compris tout l’intérêt d’harmoniser le système de numérotation des chapitres et des versets.
Estienne n’est pas le premier à avoir divisé le texte de la Bible en versets. D’autres l’avaient déjà fait. Par exemple, des siècles plus tôt, des copistes juifs avaient divisé toute la Bible hébraïque — la partie que beaucoup appellent Ancien Testament — en versets mais pas en chapitres. Là encore, comme pour la division en chapitres, il n’y avait pas de système uniforme.
Les chapitres
La division de la Bible en chapitres est attribuée à l’ecclésiastique anglais Étienne Langton, qui deviendra archevêque de Cantorbéry. Il a accompli ce travail au début du XIIIe siècle, quand il était enseignant à l’université de Paris (France).
Avant Langton, des érudits avaient essayé différentes façons de diviser la Bible en plus petites sections, ou chapitres ; le but principal était, semble-t-il, d’avoir des références pour les citations. Vous pouvez imaginer combien il leur aurait été plus facile de trouver un passage dans un seul chapitre plutôt que dans tout un livre — comme celui d’Isaïe qui a maintenant 66 chapitres.
Qui a écrit la bible
Deux des évangiles ont été écrits par les apôtres Matthieu et Jean, des hommes qui ont connu Jésus personnellement et voyagé avec lui pendant plus de trois années. Les deux autres livres ont été écrits par Marc et Luc, des associés proches des apôtres. Ces auteurs avaient directement accès aux faits qu'ils rapportaient. L’Église primitive a accepté les quatre évangiles parce qu'ils étaient en accord avec ce que tout le monde savait déjà de la vie de Jésus.
Ancien testament
L'Ancien Testament aussi appelé Ancienne Alliance, Écrits vétérotestamentaires, Premier Testament ou Bible hébraïque, désigne l'ensemble des écrits de la Bible antérieurs à Jésus-Christ. L'Ancien Testament est donc la Bible juive, le Talnakh. Pour les chrétiens, il forme la première partie de la Bible, la deuxième partie, appelée Nouveau Testament, étant constituée de l'ensemble des livres relatifs à la vie de Jésus-Christ (Évangiles, Actes des Apôtres, Épîtres de Paul et épîtres universelles, Apocalypse).
Le nouveau testament
Le Nouveau Testament est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples qui ont été reconnus comme « canoniques » par les autorités chrétiennes au terme d'un processus de plusieurs siècles. La liste des textes retenus par l'Église pour former le Nouveau Testament a été fixée en 363 lors du Concile de Laodicée ; cependant, elle ne comprenait pas encore le texte de l'Apocalypse.
Le mot « testament » vient du latin testamentum, « testament, témoignage », « testament, contrat, convention ». Le mot grec a un sens plus large que le mot latin, puisqu'il comporte la notion de contrat. Aussi certains préfèrent-ils le traduire par « alliance ».
Pour le christianisme, la Bible se compose de l'Ancien Testament (c'est-à-dire la Bible hébraïque) et du Nouveau Testament.
Tables de la loi
Dans la Bible, les Tables de la Loi sont des tables en pierre sur lesquelles Dieu a gravé le Décalogue remis à Moïse (cf l'Exode). Leur figuration traditionnelle est devenue un des symboles du judaïsme, utilisé en particulier au fronton des synagogues.
Bien qu'étant représentées comme ayant des bords supérieurs arrondis, leur vraie représentation serait en fait carrée.
Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte depuis trois mois et se trouve dans le désert du Sinaï. Dieu décide de sceller une alliance avec lui et Moïse en est l'intermédiaire. Dieu énonce dix Paroles et les assortit de développements, le code de l'Alliance. Moïse écrit toutes les paroles prononcées par Dieu mais celui-ci lui promet des tables de pierre rappelant la loi et le commandement que le peuple d'Israël devra garder dans un coffre (arche de l'Alliance) à poser sur une table et à installer dans une tente (la Demeure). Ces instructions prennent 40 jours à l'issue desquels Dieu donne à Moïse « Les tables de la charte, écrites de la main de Dieu », tables « œuvres de Dieu », « écrites des deux côtés », « écriture de Dieu ».
Bouverot (ou Bouvrot) :
Bien-fonds attaché à la cure. Il se composait non seulement de terres labourables, mais souvent aussi de prés et de vignes, parfois même de chènevière. Comme le dit Michel Pernot, le mot est lorrain, mais la chose existait aussi dans les campagnes parisiennes. Les revenus du bouvrot s’ajoutait à ceux de la dîme ou à la portion congrue.
Bréviaire :
Livre de prières appelé aussi Liturgie des Heures, par lesquelles l’Église loue Dieu et intercède pour toutes les intentions du monde aux différents moments de la journée. A la demande du concile Vatican II, le pape Paul VI a réformé le bréviaire. Cette nouvelle présentation porte le titre de : "Prière du temps présent". Elle permet aussi bien la récitation privée que communautaire. Il existe des adaptations de la liturgie des heures pour les laïcs (Bréviaire des fidèles, Nouveau bréviaire des laïcs, Les heures du jour…).
Calice :
du mot grec kulix, est un vase sacré de la liturgie chrétienne, présentant la forme d'une coupe évasée portée sur un pied élevé. Il est employé dans la célébration eucharistique pour la consécration du vin, devenant ainsi le sang du Christ. Le calice rappelle la coupe de vin de la Cène, le Saint Calice.
Calvaire :
C’est un monument chrétien, un crucifix (croix sur laquelle est représenté Jésus crucifié) autour duquel se trouvent un ou plusieurs personnages bibliques : le bon et le mauvais larron, la Vierge Marie, saint Jean, Marie-Madeleine, etc.
Le mot « calvaire » provient du latin calvaria, lui-même provenant de l'araméen golgotha.
Camérier :
Moine chargé des finances. Il a la garde du trésor, des reliques, des fonds, des archives, des titres de propriété. Il a en outre la charge de veiller sur le mobilier, les vêtements et l'hygiène.
Canoniser :
Mettre au nombre des saints suivant les règles et avec les cérémonies prescrites par l’Église. La canonisation est prononcée par le pape.
Casuel :
Offrande des fidèles et paiement des cérémonies selon tarif fixé.
Catéchèse :
Enseignement des principes de la foi. Elle repose sur le contenu de l’Écriture, l’enseignement du Christ et la tradition ecclésiale. Elle est indissociable de la célébration liturgique.
Cathédrale :
Une cathédrale est, à l'origine, une église où se trouve le siège de l'évêque (la cathèdre) ayant la charge d'un diocèse. La cathédrale est en usage dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église anglicane… Le prêtre qui supervise les offices et la gestion d'une cathédrale est appelé « archiprêtre » (ou « recteur-archiprêtre » si celle-ci a le rang de basilique).
Une « pro cathédrale » est une cathédrale provisoire : soit une église qui assume provisoirement la fonction de cathédrale sans en avoir le titre canonique, en raison de l'indisponibilité de la cathédrale « titulaire » (en travaux, en construction, démolie, etc.).
Une « Co cathédrale» est un édifice religieux élevé au rang de cathédrale alors qu'il en existe une autre dans le diocèse. La Co cathédrale latine de Jérusalem en est un exemple.
Cathèdre :
Du grec kathèdra : « siège », « chaire ». Dans la langue liturgique, la cathèdre est le siège épiscopal, le fauteuil à partir duquel l’évêque préside l’assemblée liturgique. Dans les églises anciennes, la cathèdre était placée dans l’axe de l’édifice, au fond de l’abside.
Cellérier :
Moine qui est chargé par le Père Abbé de veiller à tout le temporel (les biens matériels) du monastère. Saint Benoît lui consacre tout un chapitre dans sa Règle (31e). Sa charge délicate permet aux autres moines d'être plus disponibles pour la prière.
Cénobites :
Moines qui vivent en communauté dans un monastère sous la direction d'un abbé.
Chaire :
Tribune élevée d’où parle le prédicateur. Elle est souvent surmontée d’un abat-voix qui rabat le son vers l’auditoire. La chaire a remplacé l’ambon qui était dans le chœur. Actuellement on est revenu à l’ambon.
Chancel ou banc de communion :
Dans l'architecture ecclésiastique, le chancel (du latin cancelli, « treillis », « barrière », « balustrade »), est une clôture basse en bois, en pierre ou en métal qui sépare la nef d'une église chrétienne où sont réunis les fidèles du chœur liturgique réservé au clergé. Dans les églises paléochrétiennes et médiévales, cette clôture se nomme « chancel », pour les périodes suivantes, elle est appelée « clôture de chœur ».
Parfois appelée « clôture de chœur », cette dernière peut se distinguer du chancel car elle peut être une clôture haute constituée de bois, de pierre ou d'une grille en fer forgé.
Chancelier diocésain :
Chrétien chargé de l’établissement et de la conservation des archives et de tous les actes du diocèse, entre autres les actes de catholicité (baptême, confirmation, mariage).
Chapelle :
Une chapelle est un édifice religieux et lieu de culte chrétien qui peut, selon le cas, constituer un édifice distinct ou être intégré dans un autre bâtiment.
On désigne comme chapelle soit un édifice religieux secondaire dans une paroisse, soit un lieu de culte au sein d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments ayant une fonction précise (château, hôpital, école, cimetière, etc.).
Chapelles rayonnantes :
Petites chapelles qui entourent le chœur.
Chapitre :
Corps de clercs doté de la personnalité juridique dont la principale fonction est de rendre à Dieu un culte solennel dans une église cathédrale ou collégiale.
Dans la tradition catholique, le chapitre d'un Ordre ou d'une Congrégation religieuse est l'assemblée des religieux, clercs, frères ou religieuses, réunie dans des conditions et pour des raisons définies par la règle. Chaque abbaye a son chapitre à intervalles réguliers, voire quotidiens.
Son origine remonte au Moyen Âge. Ici, le "chapitre" fait allusion au clergé, où le chapitre désigne le corps des chanoines d'une église importante, dans laquelle l'assemblée des moines et chanoines, traite des affaires de leur communauté. Au cours de l'assemblée, les chanoines et leurs supérieurs avaient une voix, lors de la délibération. Avoir voix sur un chapitre, signifie donc, avoir le pouvoir d'exprimer son une opinion.
Châsse :
Une châsse (du latin capsa, « boîte, caisse » puis « cercueil ») désigne généralement un reliquaire contenant le corps d'un saint (entier, ou sa plus grande partie), voire de deux ou trois s'il s'agit par exemple de saints martyrisés ensemble. Il s'agit donc d'une sorte de cercueil-reliquaire.
Christianisme :
Ensemble des confessions fondées sur la personne et l’enseignement évangélique de Jésus-Christ. Le christianisme regroupe les traditions catholiques, protestantes et orthodoxes. La foi trinitaire en assure les fondements en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu c’est-à-dire Dieu lui-même.
Chœur :
Partie d'une église qui abrite l'autel et dont l'accès est réservé au clergé. Stricto sensu, c'est la partie droite entre le transept et l'abside, même qui par extension, il peut désigner l'ensemble. Dans les cathédrales, il est très souvent entouré d'un déambulatoire, dont il est séparé soit par une grille, soit par des clôtures (de bois ou de pierre), et de chapelles. Le chœur a souvent été, également, séparé de la nef par un jubé, ce qui rompait l'unité de l'espace dont on bénéficie désormais en entrant dans la plupart des cathédrales.
Ciboire :
est un vase sacré, utilisé dans plusieurs liturgies chrétiennes. En général fermé d'un couvercle surmonté d'une croix, il est destiné à contenir les hosties consacrées par le prêtre durant la cérémonie eucharistique, soit pour les distribuer aux fidèles au moment de la communion, soit pour les conserver dans le tabernacle ou l'armoire liturgique .
Lorsqu'il contient des hosties consacrées, le ciboire doit être revêtu du pavillon(de), étoffe circulaire de tissu blanc ou doré.
Le ciboire ne doit pas être confondu avec le calice, ni avec la pyxide.
Cloître :
Le cloître est constitué de quatre galeries encadrant un jardin. On trouve souvent deux points d'eau : un puits au centre (destiné à collecter les eaux de pluie) et un lavabo sur l'un des côtés (pour les ablutions). C'est à la fois un lieu de méditation et un lieu de passage. Dans les monastères, la salle capitulaire, l'église, le réfectoire (entre autres) ouvrent souvent sur le cloître
Collation :
Privilège de nomination à un bénéfice ecclésiastique. D’abord réservé à l’évêque, il passa ensuite aux monastères, puis fut progressivement accaparé par des seigneurs laïcs à l’époque féodal (Xe et XIIe), sans que les monastères perdent totalement ce privilège.
Collégiale :
Une collégiale (raccourci pour église collégiale) est une église qui possède un chapitre de chanoines composé d'un nombre fixe de clercs séculiers. Tous les chanoines possèdent un siège dans le chœur de l'église afin de s'y réunir et d'y chanter ou réciter l'office divin, une maison canoniale, un revenu et des fonctions précises.
Collégiale et cathédrale :
Comme une cathédrale, une collégiale est une église capitulaire : c'est-à-dire qu'elle possède un chapitre de chanoines. À ce collège de prêtres il incombe de chanter quotidiennement l'office divin et d'accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l'église.
Collégiale et église paroissiale :
Une église collégiale est une église paroissiale d’une certaine importance dotée de fonctions et d'œuvres pieuses ou charitables particulières qui s'étendent sur d'autres paroisses, comme l'instruction des enfants, le secours des pauvres, etc.
Toutefois, le code de droit canonique de 1983 interdit l'union des paroisses à un chapitre de chanoines et oblige l'évêque diocésain à séparer celles qui seraient unies à un chapitre de chanoines.
Commanderie :
Base de l'organisation territoriale des ordres religieux et militaires (ordre des Templiers, ordre de Malte, ordre teutonique, etc.). Lieu de vie d'une communauté de frères, de chevaliers et d'affiliés.
Le plus souvent rurales et situées sur des terres de rapport, les commanderies pouvaient aussi être urbaines et même portuaires, lorsque les chevaliers obtenaient le monopole ou bien des privilèges de commerce, ou de transport de pèlerins.
Complies :
Les complies (du latin : completorium, « achevé, terminé ») est la dernière prière chrétienne du jour (après le coucher du soleil) dans la Liturgie des Heures (Prière quotidienne chrétienne).
C'est la dernière prière de la journée, chantée par les fidèles peu après le coucher du soleil et juste avant d'aller dormir. Dans les monastères, cette prière est suivie d'un grand silence qui durera jusqu'à l'office des laudes. Le grand silence est conservé en général jusqu'à neuf heures du matin environ, jusqu'après l'office de tierce (dans les monastères bénédictins et cisterciens principalement). Les clercs séculiers sont astreints eux aussi à cet office de complies ; ils peuvent le dire à une heure adaptée à leur activité pastorale, mais de préférence peu avant le coucher.
Concile :
Un concile Dans l’Église catholique, il désigne la réunion de l’ensemble des évêques en communion avec l'évêque de Rome, le Pape, et régulièrement convoqués en assemblée par lui. Un concile peut être « œcuménique », c’est-à-dire universel quand il réunit la totalité des évêques (c’était le cas des conciles d’avant le schisme d’Orient), « général » quand il réunit l’ensemble des évêques catholiques du monde (c’est le cas du concile Vatican II bien qu’on ait pris l’habitude de l’appeler « œcuménique »), national ou provincial.
Il s'agit donc d'une assemblée d'évêques qui établit les doctrines, les dogmes (concile œcuménique) et de discipline commune (conciles généraux et conciles particuliers). Une des formes de leurs décisions est le canon ou loi.
On distingue cinq sortes de conciles répartis en deux catégories principales : les conciles œcuméniques et les conciles particuliers.
Les conciles généraux sont les assemblées de tous les évêques appartenant à une même communion ecclésiale. En ce cas, œcuménique prend son sens premier et étymologique d'universalité. Il ne désigne pas toutes les Églises chrétiennes mais toutes les parties (évêques, fidèles, diocèses) d'un même ensemble ;
Les conciles particuliers où ne sont convoqués qu'une partie des évêques.
Parmi les conciles particuliers on distingue :
Les conciles nationaux ou pléniers, composés de tous les évêques d'un État ;
Les conciles régionaux (aussi pléniers), composés de tous les évêques de plusieurs provinces ecclésiastiques formant une région (actuellement par exemple en Italie).
Les conciles provinciaux, convoqués par un évêque métropolitain, où sont réunis les évêques d'une province ecclésiastique ;
Les synodes diocésains, convoqués par l'évêque du lieu.
Liste des conciles à partir du grand schisme d'Orient en 1054
Conciles généraux :
Les conciles ci-dessous réunissent, en plus des seuls évêques catholiques, les généraux des ordres monastiques, les princes et des universitaires ; tant d'Occident que d'Orient — l'Église catholique englobe l'Occident mais le dépasse tout autant, nombre d'Églises d'Orient étant unies à Rome sans être pour autant de rite latin. Les décrets de ces conciles œcuméniques ne sont actuellement reconnus que par l'Église catholique.
Huit de ces conciles sont reconnus par l'Église catholique et par l'Église orthodoxe, sept sont qualifiés d’œcuméniques par cette dernière (liste des conciles œcuméniques).
325 : Ier concile de Nicée dit concile des cinq patriarcats, il condamne la gnose et l'arianisme (doctrine d'Arius). Adoption du Symbole de Nicée. Adoption de la consubstantialité du Père et du Fils. Fixation de la date de Pâques. Adoption de l'ordre des sièges patriarcaux Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Adoption du dogme de la trinité.
381 : Ier concile de Constantinople (Églises des deux conciles) contre la négation de la divinité du Saint-Esprit et contre les ariens. Adoptions de la consubstantialité de l'Esprit saint avec le Père et le Fils, du Symbole de Nicée-Constantinople. Attribue le 2e rang au siège patriarcal de Constantinople, reléguant Alexandrie au troisième rang.
431 : Ier concile d'Éphèse (Églises des trois conciles) proclame Marie Mère de Dieu et condamne Nestorius. Proclame l'Unité de Personne en Jésus-Christ. Adoption du Symbole d'Éphèse en 433.
451 : concile de Chalcédoine condamne la doctrine d'Eutychès selon lequel le Christ n'aurait qu'une seule nature, Divine, la nature humaine étant en quelque sorte absorbée par la nature divine, doctrine dite des monophysites. Au contraire, le concile affirme ses deux natures, divine et humaine en l'unique personne de Jésus-Christ. Adoptions du Symbole de Chalcédoine et de la Discipline des Sacrements.
553 : IIe concile de Constantinople condamne les œuvres suspectes du nestorianisme (Cf. Nestorius).
680-681 : IIIe concile de Constantinople condamne le monothélisme. Les monothélites, disciples de Sergius, évêque de Constantinople, modifiaient, en partie, l'erreur d'Eutychès (voir supra) : ils enseignaient qu'il n'y a qu'une seule volonté de Jésus-Christ, la volonté divine qui absorbe et anéantit la volonté humaine.
692 : concile in Trullo, dit aussi synode de Constantinople ou concile Quinisexte : il n'est qu'un complément, sur les seules questions de discipline, aux deux conciles précédents. Il n'a été reçu que par les Églises chrétiennes d'Orient.
787 : IIe concile de Nicée (Églises des sept conciles) condamne l'iconoclasme. Il autorise et précise le culte des images (pas de l'image en elle-même, mais de ce qu'elle entend représenter).
869-870 : IVe concile de Constantinople, contre le schisme de Photius. Ce concile affirme que la Tradition est l'une des règles de foi. La trichotomie est condamnée (l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit) et la dichotomie est affirmée (l'homme est composé d'un corps et d'une âme). L'Église orthodoxe ne le reconnaît pas.
Conciles généraux après 1054
Les conciles ci-dessous réunissent, en plus des seuls évêques catholiques, les généraux des ordres monastiques, les princes et des universitaires ; tant d'Occident que d'Orient — l'Église catholique englobe l'Occident mais le dépasse tout autant, nombre d'Églises d'Orient étant unies à Rome sans être pour autant de rite latin. Les décrets de ces conciles œcuméniques ne sont actuellement reconnus que par l'Église catholique.
1123 : Ier concile du Latran.
1130 : concile de Clermont. Il condamne la pratique du tournoi.
1139 : IIe concile du Latran.
1179 : IIIe concile du Latran définit les règles pour les élections pontificales.
1184 : concile de Vérone excommunie les vaudois.
1215 : IVe concile du Latran condamne les vaudois et les albigeois (cathares), décrète sur la confession, la communion, le mariage et la hiérarchie des sièges patriarcaux.
1245 : Ier concile de Lyon, réforme les règles d'élection des évêques.
1274 : IIe concile de Lyon, réforme les règles d'élection du pape.
1311-1312 : concile de Vienne condamne des bégards et des béguines.µ
1414-1418 : concile de Constance, fin du grand schisme d'Occident qui débuta en 1378, à l'ouverture du concile, trois papes se disputent le Saint-Siège.
1431-1442 : concile de Bâle affirme explicitement l'autorité des conciles sur le pape — le conciliarisme, et de ce fait n'est pas compté comme œcuménique ; il fut continué à Ferrare 1438 et à Florence (1439-1445).
1512-1517 : Ve concile du Latran – schisme luthérien (1520) – schisme anglican (1534) condamne la supériorité du concile sur le pape et réaffirme, par la bulle Æternus Pastor, la supériorité du pape.
1545-1563 : concile de Trente définit la foi catholique sur les points niés par le protestantisme et entreprend une réforme radicale du fonctionnement de l'Église. Il fixe la doctrine sur le nombre et la nature des sacrements, réorganise l'Église autour du prêtre et renforce la primauté du pape.
1869-1870 : Ier concile du Vatican, définit le dogme de l'infaillibilité pontificale.
1962-1965 : IIe concile du Vatican.
Conclave :
Du latin conclave, chambre fermée à clé. Désigne le lieu où s'assemblent les cardinaux* pour élire un nouveau pape, et l'assemblée elle-même.
Confrérie :
Association créée à des fins pieuses par des gens d'un même métier ou bien groupés autour d'une même dévotion. Le but de la confrérie est habituellement caritatif.
Congrégation :
La congrégation est un ensemble structuré de prêtres, de religieux, de religieuses regroupé et organisé autour d’un projet fondateur spirituel et pastoral.
Consistoire des cardinaux :
C’est la réunion des cardinaux à la demande du pape lors de la nomination des nouveaux cardinaux ou pour se pencher sur une question particulière. En consistoire ordinaire, le pape approuve les décrets concernant la cause des saints.
Couvent :
Maison d'une communauté religieuse d'hommes ou de femmes qui est dirigé par un supérieur et non par un abbé.
Ce nom se distingue de monastère qui désigne le lieu où se rassemblent les moines et les moniales. (Du latin conventus : assemblée, communauté).
Dans les temps anciens, notamment au XIIIe siècle, les couvents ont été habités par les ordres mendiants (exemple : Antonins, Dominicains, Franciscains...), des ordres religieux qui ont pour principale vocation de servir les pauvres et prêcher l'évangile.
Les couvents sont construits, à cette époque, pour accueillir les pauvres sans abris.
Crypte :
Chapelle souterraine, généralement placée sous le chœur d’une église. Son origine est liée au culte des martyrs, elle servait à cacher, aux yeux des profanes, les tombeaux des martyrs.
Curé :
Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a « charge d'âmes » d'une paroisse (en latin, cura animarum). Il est nommé par un évêque, dont il est le représentant et le délégué dans la paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent.
Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou prêtres habitués.
Le curé, assisté par ses vicaires, occupait une place centrale et jouait un rôle essentiel dans les paroisses sous l'Ancien Régime et dans une moindre mesure au XIXe siècle.
Le curé dit la messe, les enterrements, les mariages et les baptêmes.
Custode :
Du latin custodia : garde
Petite boite en métal doré dans laquelle on dépose une ou plusieurs hosties consacrées pour porter aux malades.
Définiteur :
Moine nommé au chapitre pour traiter la discipline.
Denier du culte :
L’Église ne reçoit de subvention ni de l’État ni du Vatican ; elle ne vit que des dons de ses membres. Chaque année, la campagne du denier de l’Église permet de récolter les fonds nécessaires pour assurer le traitement des prêtres et des laïcs salariés des diocèses.
Le denier du culte — dans un premier temps nommé le denier du clergé — est une contribution libre et volontaire demandée à tous les catholiques. C'est la seule source de rémunération des prêtres et des laïcs salariés travaillant pour l'Église. Il sert également au paiement des cotisations sociales, à l'entretien, au chauffage, aux assurances, aux frais de catéchèse (enfants ou adultes), de pastorale, d'entraide, etc.
Dîme :
Impôt en nature auquel tous les habitants de la paroisse (clercs, nobles, roturiers) sont théoriquement assujettis pour l’entretien du desservant, et qui correspond environ au dixième des productions agricoles ou artisanales, ou des revenus commerciaux ou seigneuriaux. Les non roturiers s’exemptèrent progressivement de ce paiement.
Diocèse :
Le diocèse ( « administration, gouvernement ») est une circonscription territoriale de l'Empire romain conçue sous Dioclétien, à la fin du IIIe siècle.
Le terme a été adopté par l'Église catholique pour désigner le territoire canonique d'un évêché, qui était initialement appelé paroisse. C'est donc le territoire placé sous la responsabilité d'un évêque. Dans les Églises orthodoxes et les Églises catholiques orientales, on utilise plutôt le mot éparchie : dans les pays slaves orthodoxes sa signification est la même, mais ailleurs, en Grèce notamment, il a acquis une connotation plutôt civile et politique.
Docteur de l’église :
L’Eglise attribue officiellement ce titre à des théologiens auxquels elle reconnaît une autorité particulière de témoins de la doctrine, en raison de la sûreté de leur pensée, de la sainteté de leur vie, de l’importance de leur œuvre.
Droit canon :
Du latin directum, ce qui est juste, et du grec kanôn, mesure, règle. Les Pères de l'Eglise* ont employé ces termes pour nommer le recueil des livres bibliques reconnus par l'Eglise, la loi ecclésiastique et, plus particulièrement, les décrets des conciles* relatifs à la foi et à la discipline. Le droit canon est l'ensemble des dispositions juridiques établies par l'autorité ecclésiastique. Il a pour objet la régulation de la vie sociale du groupe ecclésial ; précise la mission de l'institution ; définit le statut des fidèles et les organes du gouvernement ; fixe les procédures diverses.
Eglise :
Une église est un édifice religieux dont le rôle est de faciliter le rassemblement d’une communauté chrétienne. Son érection est commandée par le clergé.
L’histoire de l’édification des églises suit l’implantation du christianisme.
L’architecture obéit un mode évoluant avec les siècles et selon son importance et sa fonction, de chapelle à des monuments plus important jusqu’à la cathédrale.
Dans la religion chrétienne il n’y a pas de règle architecturale pour sa construction.
Depuis les origines et jusqu’au XVème siècle l’édifice est orienté vers l’orient (origine du mot orientation).
Les premières églises un peu clandestines étaient des maisons églises comportant une grande pièce d’un membre de la communauté.
Lorsque l’on décidait de construire une église on choisissait un saint protecteur de cet édifice.
L’art de ces églises va du roman, arc en plein cintre qui forme un cercle parfait, technique héritée de l’antiquité, l’art gothique emploi de l’arc brisé dont la clé de voute forme un angle entre les deux arcs et surtout utilisé pour bâtir les cathédrales, l’architecture contemporaine, église bâtie à partir des années 1920.
Encyclique :
Lettre solennelle du Pape adressée à l’ensemble de l’Eglise catholique ou plus spécifiquement à une des parties d’entre elles évêques, clergé, fidèles. Les encycliques sont des textes qui ont le plus souvent valeur d’enseignement et peuvent rappeler la doctrine de l’Église à propos d’un problème d’actualité.
Epiclèse :
En grec : prière, invocation
Dans la célébration eucharistique, c’est une prière qui appelle l’intervention de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est invoqué par l’imposition des mains sur le candidat et l’eau du baptême, sur le front du confirmé, sur le pain et le vin de l’Eucharistie, sur le malade, sur le candidat aux ministères ordonnés, sur le pénitent.
Episcopat :
Dignité, charge confiée à l’évêque, successeur des apôtres. C’est le temps pendant lequel un évêque est responsable d’un diocèse. C’est aussi l’ensemble des évêques.
Ermite :
Solitaire se livrant à la prière, à la méditation, au travail manuel et intellectuel, et à la pénitence.
Exorcistes :
Clercs ayant reçu l'ordre mineur de l'exorcistat et héritier dans l'église primitive, des fidèles chargés de s'occuper des personnes possédées par le démon.
Fabrique :
Biens et revenus appartenant à une église et destinés aux frais du culte et à l'entretien de l'église : corps de marguilliers ou fabriciens chargés de l'administration de ces biens.
Fanal funéraire ou lanterne des morts :
Petits édifices construits dès le XIIe siècle dans les cimetières et encore en nombre dans le Limousin ou le Poitou, les lanternes des morts ou fanaux funéraires protégeaient de leur lueur soigneusement entretenue, les défunts. On les trouve aux abords des cimetières ou des anciens cimetières si ceux-ci ont disparu au fil du temps. Survivance d'un rite religieux d'origine celte, on pensait aussi que la lumière protectrice dégagée de ces lieux durant la nuit, pouvait retenir la mort et l'empêcher d'aller rôder et faire de nouvelles victimes.
Genèse :
Du grec : genesis, commencement
Premier livre du Pentateuque, raconte comme son nom l’indique, les origines du monde et le début de l’action de Dieu parmi les hommes.
Heures canoniales :
Traditionnellement, la journée comporte sept heures canoniales et la nuit une
Matines ou vigiles : milieu de la nuit (minuit) ;
Laudes : à l'aurore ;
Prime : première heure du jour ;
Tierce : troisième heure du jour ;
Sexte : sixième heure du jour ;
None : neuvième heure du jour ;
Vêpres : le soir ;
Complies : avant/après le coucher.
Inquisition :
La Sainte Inquisition est une juridiction ecclésiastique spécialisée dans la lutte contre les hérésies, qui joua un rôle important du XIIIe au XVIe siècle. Organisée en 1231 par Grégoire IX, qui la confia aux dominicains, sa première mission fut d'éliminer les cathares, mais elle se chargea par la suite de faire brûler les templiers, des juifs, des musulmans. Innocent IV autorisa l'usage de la question dès 1252. En France, son importance décrut dès la fin du XIVe siècle, alors qu'elle allait connaître son plein essor en Espagne, de 1478 à 1484, sous l'impulsion des rois catholiques et du terrible Torquemada. En 1542 est créée à Rome la Congrégation de la Suprême Inquisition, qui s'occupa du protestantisme et d'autres hérésies. La congrégation changea de nom en 1908 (Congrégation du Saint Office) pour devenir la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1965.
Intrados :
Surface intérieure d'un arc ou plutôt d'un ensemble d'arcs (voussures). Si beaucoup d'intrados romans ne sont pas ornés (comme à Moissac), les intrados des portails gothiques le sont quasiment tous
Jansénisme :
Courant religieux et doctrinal, fondé sur les écrits de Jansénius. Il nie le libre arbitre de l’homme en insistant sur le rôle déterminant de Dieu dans le salut des âmes. La Constitution Apostolique « Unigenitus Dei filius », (le Fils unique engendré par Dieu), est une bulle pontificale promulguée par le Pape Clément XI qui renouvelle la condamnation de cette doctrine. La morale janséniste est rigoriste et austère.
Laudes :
Office du matin qui se récite au lever du jour. Il tire son nom des laudes (en latin), les trois derniers psaumes du psautier (Ps 148 ; 149 ; 150) qui invitent toute la création à louer Dieu, c'est donc l'office de la louange par excellence. Y est célébrée quotidiennement la victoire de la lumière sur les ténèbres, image de la victoire du Christ sur la mort par sa résurrection.
Marguillier :
Laïque chargé de l'administration des revenus d'une fabrique ; les marguilliers étaient élus dans les villes par une assemblée de personnes notables ; ils réglaient les tarifs des bancs à l'église, des inhumations, discutaient les acceptations de legs, de fondations, nommaient les chantres, bedeaux, sonneurs et avaient avec le curé la garde des clefs et des ornements de l'église.
Matines :
(Ou vigiles). Office de la fin de la nuit dans la règle bénédictine, il correspond à un aspect essentiel de notre vocation de veilleurs. En effet, cette prière matinale est une réponse à l'appel du Seigneur de veiller, pour ne pas être surpris par son retour. Récité recto tono, cet office commence tous les jours par le psaume 94e qui invite les fidèles à venir adorer Dieu. Outre le chant de psaumes, cet office comprend d’assez longues lectures de la Bible, des Pères de l’Église, d’écrivains ecclésiastiques et du Magistère de l’Église.
Mauriste (congrégation de Saint-Maur) :
La congrégation de Saint-Maur, souvent connue sous le nom de mauristes, était une congrégation de moines bénédictins français créée en 1618, connue pour le haut niveau de son érudition. La congrégation et ses membres tirent leur nom de saint Maur (décédé en 565), disciple de saint Benoît auquel on attribue l'introduction en Gaule de la règle et de la vie bénédictines.
La suppression de la Congrégation en 1790 par l'Assemblée constituante.
Monastère :
Un monastère est un ensemble de bâtiments où vit une communauté religieuse de moines ou de moniales. Il en existe dans les religions chrétiennes et bouddhiste.
Nonce apostolique :
Agent diplomatique du Saint Siège, accrédité comme ambassadeur du pape auprès des États.
None :
Est la prière chrétienne de la neuvième heure du jour (15h) dans la liturgie des Heures (Prière quotidienne chrétienne).
C'est aussi, par extension, le nom de l'office chrétien récité à la neuvième heure du jour par les moines ou laïcs. Il est donc habituellement chanté ou dit vers 15 heures. Il commémore l'instant où le Christ est mort sur la Croix.
Obituaire :
Registre où étaient inscrits les obits dus aux fondateurs ou bienfaiteurs d'une église ou d'une maison religieuse.
Obits :
Les obits étaient des offices funèbres fondés en mémoire d'un fondateur, d'un donateur.
Opus Dei - Œuvre de Dieu ou Office divin ou Liturgie des Heures :
Expression que Saint Benoît emploie pour désigner les célébrations liturgiques de la communauté en dehors de la Messe. Elle désigne de manière spécifique les temps de prière commune à l'église au long de la journée, qui forment comme une couronne autour de la Messe, et par lesquels la communauté se rassemble pour louer Dieu et intercéder auprès de Lui en faveur de tous les hommes. L’Œuvre de Dieu comprend les Matines, les Laudes, Prime, Tierce, Sexte, None, les Vêpres et les Complies.
Oratoire :
Un oratoire est un lieu consacré à la prière ou petit édifice appelant à la prière, pour invoquer la protection divine. Plus précisément, ce terme désigne (dans un large bâtiment) une pièce particulière consacrée à la prière personnelle ou, comme édifice indépendant, un petit monument voué au culte d'un saint ou d’une sainte représentée par une statuette ou parfois tout simplement par une simple plaque à son image ou une croix.
Paroisse :
Une paroisse est une organisation qui est originellement, dans le christianisme, la subdivision de base d'un diocèse de l'Église. La paroisse occupe un rôle essentiel dans la vie religieuse, elle est le lieu de culte, de célébration pour les croyants.
Etendue de territoire soumis à la conduite spirituelle d'un curé en même temps
Patène :
Du latin patena ou patina : « plat creux ». La patène est le vase sacré, de forme circulaire et concave, destiné à recevoir l’hostie pour la célébration de la messe. Faite en matière solide et noble, souvent en métal précieux, elle est assortie au calice.
Petites Heures :
Temps de prière commune d’environ un quart d’heure qui comprennent les offices de Prime (première heure), Tierce (troisième heure : neuf heures), Sexte (sixième heure : midi) et None (neuvième heure : quinze heures), ainsi nommés d’après la façon de mesurer le temps dans l’antiquité qui faisait commencer la journée à six heures.
Portion congrue :
Signifie part convenable, mais, par antiphase, l’expression est devenue synonyme de salaire insuffisant. Elle faisait du curé, en principe au moins, une sorte de pensionné recevant périodiquement une somme fixe.
Pouillé :
Liste des paroisses d'un diocèse.
Prébende :
Revenu affecté à un canonicat, et pris sur la mense capitulaire. Il y avait aussi des semi-prébendes, attribuées à des chapelains, à des remplaçants, à des chanoines désignés sous le nom de vicaires, à des enfants de chœur, etc. Certains chanoines pouvaient n'avoir qu'une demi-prébende, et n'avaient qu'une demi-voix aux assemblées du chapitre.
Presbytère :
C’est l’habitation du curé chez les catholiques ou du pasteur protestant.
Il est souvent situé à proximité des églises paroissiales ; dans certaines localités, ses qualités architecturales ou son importance historique ont pu amener à le classer au titre des monuments historiques.
La construction des presbytères était financée par les paroisses. Si le presbytère appartient toujours à la paroisse (ou plus exactement, pour les lois républicaines en France, à l’association cultuelle locale), il n’est pas rare qu’en cas de difficultés financières, elle commence par vendre ce dernier.
Prêtre :
Du grec presbutéros qui, comme presbus ou presbutès, signifie « ancien », « ambassadeur ». Le terme de « prêtre » implique donc à la fois une respectabilité et une charge de médiation.
Prieuré :
Monastère dépendant généralement d'une abbaye et dirigé par un prieur, une prieure
Primatiale :
Cathédrale où siège le Primat .
Prime :
Prime est la première heure du jour après le levant, c'est-à-dire vers 8 h du matin.
C'est aussi, par extension, le nom de l'office chrétien récité à la première heure du jour par les chrétiens pratiquants, moines ou laïcs. Il est donc habituellement chanté ou dit vers 6 heures.
Correspondant à la première heure du jour, il fait partie des « petites heures ». La "Constitution sur la Sainte Liturgie" du concile Vatican II décréta que « le cours traditionnel des Heures sera restauré de telle façon que les Heures retrouveront leur vrai temps dans la mesure du possible » et, en considérant « les laudes comme prières du matin » décida que la prière à « l'Heure de Prime sera supprimée»
Profès simple ou profès temporaire ou jeune profès :
Moine ayant prononcé des vœux de chasteté, de pauvreté, d’obéissance et de stabilité pour une période de trois ans après un temps de probation – environ trois ans – au noviciat de l’abbaye.
Profès solennel :
Moine ayant prononcé des vœux de chasteté, de pauvreté, d’obéissance et de stabilité jusqu’à la mort. La profession solennelle intervient après au moins six ans de vie monastique.
Pyxide :
Est un vase sacré en forme de boîte utilisé pour conserver la réserve eucharistique (les hosties consacrées). La pyxide peut être en ivoire, éventuellement sculpté, ou en métal précieux ou doré.
Requiem :
Ou messe de Requiem, est une messe de l'Église catholique qui a lieu juste avant un enterrement ou lors de cérémonies du souvenir. C'est une prière pour les âmes des défunts, aussi connue sous le nom latin de Missa pro defunctis ou Missa defunctorum (Messe pour les défunts ou Messe des défunts). Elle est parfois pratiquée par d’autres Églises chrétiennes comme les Églises anglicane et orthodoxe.
Reliquaire :
Un reliquaire est un réceptacle, généralement un coffret, destiné à contenir une ou plusieurs reliques. La dévotion populaire cherchant à honorer ceux dont les restes mortels étaient préservés fit que tout un art se développa, créant des reliquaires en matériaux précieux de forme et style esthétique divers.
Retable :
À l’origine, le retable est un simple meuble de bois ou de pierre placé derrière l’autel, dont la fonction semble soit utilitaire (gradins destinés à recevoir des objets liturgiques). Les retables se développent à partir du Moyen âge en ayant plutôt une dimension décorative liée à la fonction religieuse. Leur iconographie évoque la vie du Christ de la Vierge et des Saints, mais c’est au 17ème et 18ème siècle que le retable prend de l’importance, il devient une véritable œuvre d’art.
Sacerdoce :
Indique la fonction de médiation entre Dieu et l’humanité. Toute l’Eglise est un peuple de prêtres, c’est-à-dire un peuple sacerdotal. Par le Baptême, tous les baptisés participent au Sacerdoce unique du Christ. Cette participation s’appelle "sacerdoce commun des fidèles". Sur cette base et à son service, le ministère sacerdotal des évêques et des prêtres, conféré par le sacrement de l’ordre, participe de manière spécifique à la mission du Christ.
Sacristain :
Un sacristain est une personne (laïque ou religieuse), employée par le diocèse, chargée de la tenue de la sacristie et du bon déroulement matériel des célébrations. Le sacristain prépare notamment tous les objets liturgiques nécessaires pour la messe et se consacre à l’entretien des églises et de toutes les salles annexes. En ce qui concerne les services religieux, il met en place les fleurs, actionne la sonnerie des cloches et prépare les vêtements liturgiques. Il ouvre et referme les locaux et informe les enfants de chœur.
Son travail peut être un emploi à temps plein ou une occupation à titre accessoire, cela dépend de la taille de l’église.
S'il est chargé plus généralement de la tenue de l'église, on parle alors de bedeau. Si cette personne est une femme, on parle alors parfois de sacristine. Le sacristain qui portait un costume d’apparat lors des cérémonies religieuses était jadis appelé « suisse d'église », il ouvrait notamment les processions en faisant sonner sur le dallage la hampe de sa hallebarde ou le fer de sa canne à pommeau d'argent.
Sacristie :
Du latin ecclésiastique sacristia : lieu voisin du sanctuaire, dans les églises, où est disposé tout ce qui est nécessaire aux fonctions liturgiques : ornements, vases sacrés, livres, etc.
Salle capitulaire :
Salle ouverte sur le cloître d'une abbaye, où les moines se réunissaient pour entendre de leur abbé la lecture d'un chapitre (d'où son nom) de la règle et commenter certains aspects de la vie commune.
Sanctuaire :
Du latin sancturarium : dérivé de saunctus, Saint.
Il désigne d’abord de manière générale, des lieux de culte : temples, églises, espaces consacrés à des célébrations de lieux de pèlerinage. De manière plus restrictive, c’est la partie considérée comme la plus sainte d’un édifice religieux. Dans les églises catholiques de rite latin, le sanctuaire est la partie du chœur située autour de l’autel ; c’est là que se déroulent les célébrations liturgiques et spécialement l’Eucharistie.
Séminaire :
Établissement dans lequel les jeunes qui se préparent à devenir prêtre reçoivent une formation en conséquence.
Sexte :
Office de la sixième heure du jour selon la manière de compter les heures des anciens, qui correspond au milieu de la journée. La communauté se rend ensuite au réfectoire pour le déjeuner.
Stalle :
Les stalles sont les sièges réservés aux chanoines dans le chœur (souvent clôturé). Chaque chanoine disposait d'une stalle attitrée. Le siège de l'évêque se situe normalement à l'extrémité orientale des stalles sud. La disposition de ces sièges en bois adopte la forme d'un U au sein duquel se trouve l'autel. On trouve souvent un double rang de stalles (stalles hautes et stalles basses). Le plus souvent, les sièges sont en fait des strapontins (dotés au-dessous d'une miséricorde, cf. définition ci-dessus), ce qui permettait un gain de place lorsque les religieux se devaient de rester debout pendant l'office. Les dossiers et les miséricordes des stalles ont servi de support à des sculptures sur bois parfois magnifiques, ornées de programmes souvent originaux, d'autant plus libres qu'ils n'étaient pas destinés aux fidèles
Suffragant :
Signifie littéralement « qui participe au suffrage » et désigne dans le vocabulaire chrétien un pasteur qui agit non pas de sa propre autorité mais de celle de l'assemblée qu'il représente, pour les catholiques le chapitre métropolitain. Se dit des évêques dépendant d'un archevêque.
Suisse d’église :
Suisse d’une église : celui qui, vêtu d’un uniforme spécial, coiffé d’un bicorne, armé de la hallebarde et de l’épée, est chargé de la garde d’une église et qui précède le clergé dans les processions, etc.
Le Suisse d’église existait encore dans les années 50, et fut sans doute supprimé lorsqu’on institua une seule classe pour tous les services religieux.
Synode :
Assemblée diocésaine réunie autour de leur pasteur (évêque) et de ses principaux responsables.
Tabernacle :
Appelé aussi Tente de la rencontre. Durant le séjour des hébreux au désert, la tente était le sanctuaire transportable, lieu privilégié de la présence de Dieu parmi son peuple.
Dans l’Eglise catholique le tabernacle est la petite armoire destinée, depuis le XVI° siècle, à conserver les hosties consacrées. Une petite lumière signale la présence de la réserve eucharistique.
Théologie :
Discipline qui traite essentiellement du Dieu de la foi connu dans sa Révélation. La théologie fait appel aux différentes méthodes scientifiques parmi lesquelles l’histoire tient une place particulière, en restituant les documents de la foi à leur contexte, et en s’employant à les faire revivre. Mais la théologie bénéficie des apports de la philosophie de la psychologie, de l’ethnologie et, en général, de toutes les sciences qui permettent de mieux connaître l’homme, auquel Dieu se révèle.
Tierce :
Office de la troisième heure du jour selon la manière de compter les heures des anciens, qui correspond au milieu de la matinée. Nous récitons cet office ordinairement au début de la Messe conventuelle, ce qui manifeste l'harmonie qui unit le cycle de l'office et le sacrifice eucharistique.
Transept :
Nef transversale coupant la nef principale donnant ainsi la forme d’une croix latine. Plan le plus fréquent des églises occidentales.
Vêpres :
Prière du soir – vesper en latin – qui fait pendant à la prière du matin, les Laudes.
Vigiles :
Cette prière nocturne traduit et stimule l’attente du Seigneur qui reviendra : « Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : « Voici l’époux qui vient, sortez à sa rencontre. »
« Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, de peur que, s’il vient à l’improviste, il ne vous trouve endormis. »
Cet office se dit au milieu de la nuit. Les Psaumes alternent avec une longue lecture biblique et une lecture d’un auteur chrétien ancien. Cette dernière lecture aide à mettre en lumière la fête liturgique, le saint du jour, ou un thème spirituel. Par rapport à la prière officielle de l’église, les Vigiles s’apparentent à l’Office des Lectures.
RECHERCHES Par Allain Prigent
Classement des Archives Départementales
Séries anciennes avant 1790
A actes du pouvoir souverain
B justice, parlements, baillages, Sénéchaussées, cours des comptes
C administrations provinciales
D enseignement
E fonds de familles, minutiers des notaires, Chartriers, registres paroissiaux et d’état civil
F pièces divers,
G clergé séculier
H clergé régulier
I fonds divers se rattachant aux archives Ecclésiastiques.
J séries consacrées aux dons et acquisitions de documents (existe depuis 1944)
Séries révolutionnaires
K lois, ordonnances, arrêtés
L administrations, juridictions
Séries modernes
M Personnel et administration générale, Recensement de population, Listes électorales, Décorations, dossiers des fonctionnaires
N Administration, comptabilité département
O Administration communale
P finances, cadastre
Q domaine, ventes de biens nationaux, Hypothèque
R affaires militaires
S travaux publics
T enseignement, dossier instituteurs
U justice
V cultes de la période concordataire, clergé catholique, rabbins, pasteurs
W versements récents
X assistance publique
Y prisons registres d’écrou
Z sous préfecture
L’état civil
Les premiers actes qui vous permettront de reconstituer et de prouver votre généalogie sont les actes d’état civil, créés par la I° république en 1792.
Il en existe au moins 3 sortes : Naissance, mariage et décès.
Copie intégrale acte de naissance
On y trouve :
Pour l’enfant : nom prénoms, sexe, date et heure de naissance, lieu
Pour les parents : nom prénoms, ages, professions, adresse et situation matrimoniale
Pour les témoins : qualité et adresse
Mentions marginales : Reconnaissance, adoption, légitimation ou tutelle
Copie intégrale acte de mariage
On y trouve :
Pour les époux : noms, prénoms, dates et lieu de naissance, professions
Pour les parents : noms et prénoms, quelquefois mention de leur décès au XIX° siècle. Est précisé aussi le notaire nom et adresse s’il y a eu contrat de mariage avec la date.
Pour les témoins : noms, prénoms, professions, domiciles
Mentions marginales : Le cas échéant : séparation de corps, divorce, modification du régime matrimonial.
Copie intégrale acte de décès
On y trouve :
Pour le défunt : noms, prénoms, dates et lieu de naissance, date, lieu du décès, le domicile au moment du décès
Pour les parents : noms et prénoms, les mentions de la qualité du décédé (précision du nom du conjoint même en cas de veuvage)
Pour les témoins : Indiqués avec leur parenté le cas échéant.
(Informations à relever obligatoirement en raison de l’intérêt qu’elle apporte)
Les sources officielles
Les archives communales et départementales
Outre l’état civil, les mairies conservent au sein de leurs archives des documents pouvant apporter maints renseignements sur la généalogie de la famille. Elles constituent en partie le fond de base des archives départementales. Elles ont leur propre mode de classement.
Ces archives vous permettront de rechercher l’état civil ainsi que les tables décennales.
Les sources pouvant apporter des renseignements autres que l’état civil
a) les archives culturelles
Parmi les documents ecclésiastiques, de la série G, nous pouvons trouver des détails sur l’existence de nos ancêtres. L’évêque se devait de visiter le curé de chaque paroisse afin de contrôler les registres.
Les dispenses de droit canon ne doivent pas être négligées.
Les dispenses de bans, demandées afin de ne pas attendre les 3 semaines pour se marier.
Les dispenses de consanguinité ou de parenté.
b) les enfants naturels
Au XIX° siècle, la femme n’accouchait pas dans sa ville d’origine. Malheureusement, le village de naissance de la mère n’est pas indiqué dans l’acte de naissance de l’enfant. La solution se trouve dans les tables décennales des villes environnantes. Pour supposer le père, consulter l’éventuel succession du bâtard.
Sous l’ancien régime, un édit d’Henri II (1556) oblige les filles non mariées ou veuves à déclarer leur grossesse sous peine de pendaison.
Dans ses déclarations on y trouve :
Nom, âge, origine géographique, métier de la femme et identité du séducteur et les circonstance de la rencontre.
A.D série B (cours et juridictions)
A.N séries M et O (légitimation)
c) les enfants trouvés
De 1639 à 1874 les archives de la Seine conservent les documents provenant :
Administration des Enfants Assistés
Des hospices civils de la Seine
d) recherche dans les cimetières
Archives communales série N (concessions temporaires). série M pour les gros travaux (chapelle, perpétuité)
e) les listes électorales
Jusqu’en 1945 seuls les hommes de 25 ans et plus peuvent voter.Avant 1848 âgés de plus de 30 ans et étant fortement imposable.
f) les listes nominatives
classées en série M aux Archives Départementales
établies à partir des recensements de la population.
Composition d’une famille à une date donnée.
g) les archives notariales
Actes intéressant le généalogiste car des filiations peuvent y apparaître :
contrat de mariage, testament, inventaire après décès, partage, tutelle, notoriété, donation entre vif, reconnaissance d’enfant naturel, quittance, vente, bail, procuration, obligation, rente.
h) les hypothèques
Les registres de l’an VII à 1900 sont conservés aux AD et classés en série Q
Il en existe trois sortes :
Le registre de transcription des actes notariés
Le registre d’inscription hypothécaire
Le registre de transcription de saisies
i) la fiscalité
classée en série C aux Archives Départementales, pour l’ancien régime, classée en série C aux Archives Départementales à partir de 1695
classée en série P aux Archives Départementales à compter de la Révolution
j) les justices de paix
Elles sont classées aux A.D
en série L administration époque révolutionnaire pour la période 1790-1800 puis,
en série U justice de 1800 à 1958 dates à laquelle elles sont remplacées par les tribunaux d’instance. Nous y trouvons des actes de notoriété destinés à remplacer un acte d’état civil perdu ou détruit, les conseils de famille lorsque des enfants mineurs deviennent orphelins.